|
Nous ne savons que peu de chose sur saint Maron, ou
Maroun. Nous le connaissons surtout grâce, d'une part à
Théodoret, évêque de Cyr, qui, vers 440, le mentionne
dans son Histoire des moines de Syrie (ou
histoire philothée) et d'autre part à saint Jean
Chrysostome qui, depuis son exil à Cucuse, en Arménie,
en parle dans sa
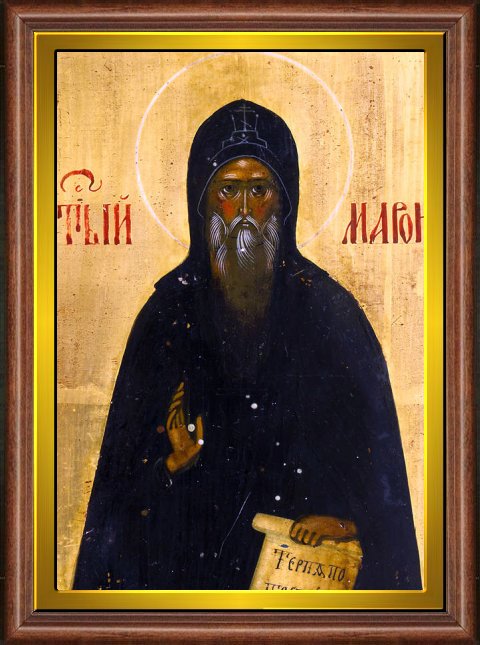 lettre
adressée à Théodoret en 405. Le chapitre 16 du livre de
Théodoret contient de nombreux détails sur saint Maron,
sur sa vie de prière, ainsi que sur l'empreinte
indéniable qu'il laissa sur les disciples qui le
suivirent. lettre
adressée à Théodoret en 405. Le chapitre 16 du livre de
Théodoret contient de nombreux détails sur saint Maron,
sur sa vie de prière, ainsi que sur l'empreinte
indéniable qu'il laissa sur les disciples qui le
suivirent.
Nous devons noter ici que saint Jean Chrysostome,
archevêque de Constantinople, dans sa lettre adressée à
Théodoret, exprime le grand respect qu'il a pour Maron.
Dans cette lettre, peut-être également envoyée à saint
Maron, ou dans une autre plus personnelle, Jean
Chrysostome demande, à saint Maron, qu'il qualifie de
prêtre solitaire, son soutien spirituel et sa prière.
L'existence de saint Maron est donc historiquement
affirmée. Il serait né vers la fin du IVe
siècle, et serait décédé vers 410. On ne connaît de lui
que sa vie d'ermite. On sait que, moine chrétien syrien,
retiré près de Cyr, sur le mont Taurus, dans la région
d'Antioche, Maron menait, en plein air, une vie de
pénitence et de prière, près d'un ancien temple païen
qu'il avait converti en église. Il n'avait, comme abri
contre les ardeurs du soleil, qu'une tente en peau.
L'austérité de sa vie, sa sainteté et les miracles qu'il
accomplissait le rendirent célèbre dans toute la Syrie.
Sous l’influence de sa vie édifiante, beaucoup de
disciples vouèrent une bonne partie de leur existence à
la prière, tandis que d’autres s’isolaient sur les cimes
des montagnes, ou se cloîtraient dans les grottes pour
communier avec Jésus-Christ et à sa vie. De plus, de
nombreux croyants, à travers l'empire Byzantin, venaient
à lui, pour solliciter sa prière, ou même, suivre ses
exemples et partager sa vie de prière, de pénitence et
d'amour de Dieu et du prochain. Car même les ermites
aimaient leurs frères…
Afin que les choses soient très claires, et compte tenu
des événements qui se passent actuellement en Syrie,
voici quelques précisions géographiques: les régions
situées au sud d'Apamée, en Syrie, qui s'étendaient
jusqu'aux frontières Libanaises, étaient divisées en
deux provinces:
– La Phœnicie Libanaise, avec Homs puis Damas pour
métropole et
– La Phœnicie Maritime avec Tyr pour capitale. Le
diocèse de Cyr eut à sa tête, en 423 l'évêque Théodoret
de Cyr. Une distance évaluée à deux jours de marche
séparait la ville de Cyr située au nord-est d'Antioche
de la ville d'Alep. Revenons maintenant à Saint Maron.
Théodoret précise qu'à son époque la plupart des
solitaires de la région de Cyr étaient des disciples de
Maron. Il indique qu'après sa mort la dépouille de Maron
fut l'objet d'un conflit entre les localités du
voisinage: l'une d'elles se l'appropria par la force et
bâtit un grand sanctuaire pour déposer le corps de Maron
et y organiser un pèlerinage. En 452, l'empereur Marcien
aurait fait construire, sur la tombe de saint Maron, le
monastère Saint Maron, comprenant trois cents cellules
de moines. Ce monastère, situé près d'Apamée, à l'est de
la ville d'Hama, au bord de l'Oronte, devint un lieu
d'importants pèlerinages.
Aux VIe
et VIIe
siècles, le monastère devint le foyer de l'Église
chalcédonienne catholique opposée aux monophysites. Le
premier disciple de saint Maron qui s'installa au Liban
dès le Ve
siècle, Abraham de Cyr, y établit une mission destinée à
convertir les derniers païens d'origine phénicienne.
Saint Maron est fêté le 9 février dans l'Église maronite
catholique et le 14 février dans l'Église orthodoxe. Le
9 février est, au Liban, une fête nationale chômée.
Paulette Leblanc |
