|
Beaucoup de personnes se posent la question: mais qui
était donc Marie de l'Incarnation pour que ses écrits
aient passionné tant de savants, d'historiens et de
biographes? Qui? Mais une simple ursuline, première
missionnaire du Canada et fondatrice de l'Église de ce
pays. Contemplative et active, cette religieuse
cloîtrée,
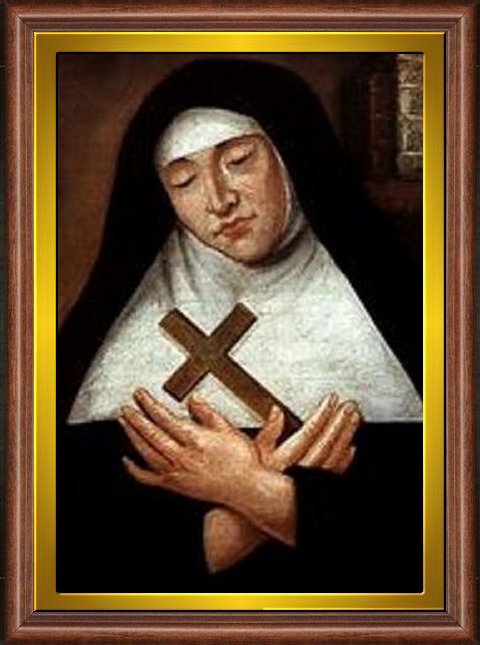 qui
réussit à maîtriser quatre langues locales, savait
apprivoiser les petites amérindiennes et gagner la
confiance de leurs parents. En 1639, Marie de
l'Incarnation et ses sœurs ursulines ouvrirent à Québec
un monastère et une maison d'éducation. Cette œuvre
résista à toutes les nombreuses épreuves qu'elle dut
traverser, et grâce à la foi des religieuses, elle
réussit à s'implanter dans d'autres régions du Québec,
et ailleurs dans le monde: au Pérou et aux Philippines
notamment. qui
réussit à maîtriser quatre langues locales, savait
apprivoiser les petites amérindiennes et gagner la
confiance de leurs parents. En 1639, Marie de
l'Incarnation et ses sœurs ursulines ouvrirent à Québec
un monastère et une maison d'éducation. Cette œuvre
résista à toutes les nombreuses épreuves qu'elle dut
traverser, et grâce à la foi des religieuses, elle
réussit à s'implanter dans d'autres régions du Québec,
et ailleurs dans le monde: au Pérou et aux Philippines
notamment.
Voyons maintenant ce que fut la vie de Marie de
l'Incarnation. Marie Guyart naquit à Tours le 28 octobre
1599. Elle était la 4ème enfant d'une famille
qui en comptera huit. Son père Florent Guyart et sa mère
Jeanne Michelet originaire de la petite noblesse de
Touraine, étaient des maîtres-boulangers. Notons ici que
ce foyer catholique, désirait aussi que ses enfants
s'instruisent. Marie avait environ sept ans quand elle
fit un songe qui marqua toute sa vie. Elle vit le ciel
s'ouvrir et Jésus venir à elle et l'embrasser. Puis Il
lui demanda: "Veux-tu être à moi?" Marie répondit "Oui!"
Dès lors, Marie recherchera toujours une vie de prière,
d'union à Dieu et de charité envers les autres.
Marie Guyart avait environ 14 ans quand elle confia à sa
mère son désir d'entrer au couvent. Madame Guyart ne
répondit pas, mais trois ans plus tard, alors que sa
fille Marie n'avait que 17 ans, elle la maria à Claude
Martin, un professionnel de la soie. Bientôt Marie
Guyart eut un fils, Claude, mais six mois plus tard son
mari mourait, laissant sa jeune femme veuve à 19 ans,
avec un enfant de six mois. De plus, Marie héritait
d'une fabrique en faillite et de plusieurs procès en
cours. Douée pour les affaires, Marie Guyart liquida le
commerce familial et les procès. Puis, elle revint chez
ses parents. Pendant environ un an, pour gagner sa vie
et subvenir aux besoins de son fils, elle s'adonna à des
travaux de broderie. Quand elle eut 21 ans, Marie Guyart,
quoique toujours dans le monde, prononça des vœux de
chasteté, de pauvreté et d'obéissance, car elle se
sentait toujours attirée vers la vie religieuse; mais,
ayant compris que l'heure de Dieu n'était pas encore
venue, elle la préparait.
Suivirent quelques années très difficiles. En effet, en
1621, pour rendre service à sa sœur et à son beau-frère,
Paul Buisson, Marie alla vivre chez eux. Paul Buisson
administrait un important commerce de transports
fluviaux, et, conformément aux habitudes de l'époque, il
hébergeait ses nombreux employés. Marie s'occupa d'abord
de la cuisine et du soin des blessés et des malades. Ses
talents pour le commerce et l'organisation furent
exploités par son beau-frère, et Marie travaillait
presque en permanence, à charger ou décharger des
marchandises en compagnie des employés, dans l'écurie
qui servait de magasin. Elle devait aussi s'occuper des
soixante chevaux dont elle avait la charge. Pourtant,
ses talents d’administratrice étaient reconnus et elle
prenait parfois le rôle de gérante lorsque les deux
"patrons" étaient absents. Mais la Vierge Marie veillait
à ce que sa "fille", pourtant débordée par le travail,
pût se rendre chaque jour à la messe et prendre le temps
de prier. Un jour, le Seigneur fit comprendre à Marie
Guyart, Madame Martin, qu'il étant temps pour elle,
d'entrer dans la vie religieuse. Elle avait 31 ans et
son fils douze ans.
Le 25 janvier 1631, Marie quitta son vieux père, et,
malgré toute sa peine, elle confia son fils, aux soins
de sa sœur. Ce fut l'un des actes les plus héroïques de
la vie de Marie de l'Incarnation. Le cœur brisé, elle
entra au noviciat des Ursulines de Tours. Durant
l'octave de Noël 1634, Marie fit un second rêve
surprenant: accompagnée d'une jeune dame, Marie avançait
vers une place où un jeune homme leur indiqua le chemin
qu'elles devaient prendre. Et Marie se retrouva dans un
immense pays plein de brumes et de brouillards. Une
petite église était la seule lumière qui éclairait les
ténèbres. En haut de l'église, la Vierge Marie, assise,
tenait l'Enfant Jésus dans ses bras et lui parlait.
Madame Martin, notre Marie, sentit que leurs échanges de
paroles la concernaient. Et bientôt le Seigneur lui dit:
"
Je veux que tu ailles au Canada construire une maison à
Jésus et à Marie."
Et cela se fit plusieurs années après, mais comment?
Curieusement, le 19 février 1639, une dame de la
noblesse, Madame de la Peltrie se présenta au Monastère
des Ursulines: elle désirait partir au Canada, et comme
elle avait appris, nous ne savons pas comment, qu'une
religieuse de Tours le désirait aussi, elle venait voir.
Instantanément, Marie de l'Incarnation reconnut dans la
visiteuse la jeune dame qui, dans son rêve de 1634,
l'accompagnait. Grand émoi chez les Ursulines car
jusqu'à présent les Ursulines ne partaient pas comme
missionnaires. Et où trouver les ressources financières
indispensables?
Pourtant, les uns après les autres, les obstacles
s'éliminèrent et les problèmes financiers furent résolus
grâce à la générosité de Madame de la Peltrie. Une jeune
sœur ursuline de 22 ans, Sœur Marie de Saint Joseph fut
désignée pour partir avec Sœur Marie de l'incarnation.
Toutes les autorisations furent accordées, et le 28
février 1639, ce fut le départ pour Paris où Madame de
la Peltrie put mettre une partie de sa fortune au
service du futur Monastère des Ursulines de Québec et à
l'ouverture d'une maison d'éducation. Enfin, le petit
groupe des futures missionnaires put se rendre à Dieppe
à destination du Canada… Et là, une nouvelle ursuline se
joignit aux deux premières, Sœur Cécile de Sainte-Croix.
Le voyage à bord du bateau, le Saint-Joseph, dura trois
mois. Le premier août 1639, ce fut l'arrivée à Québec.
Québec! Un pays couvert de brouillards, un sentier
abrupt et rocailleux et des forêts immenses: le rêve de
1634 revint à la mémoire de Marie de l'Incarnation. Les
colons français accueillirent les trois Ursulines et Mme
de la Peltrie avec tous les honneurs possibles, puis
vinrent présenter leurs filles pour les faire instruire.
Il fallut bientôt construire un Monastère et une école
pour répondre à tous les besoins des colons de la
Nouvelle France et des Ursulines. Marie de l'Incarnation
obtint l'autorisation du Gouverneur pour faire
construire un bâtiment au lieu qui lui semblait le plus
à l'abri de la menace des Iroquois. L'Ursuline prépara
les plans et les devis, embaucha des ouvriers, puis
surveilla de près la construction jusqu'à monter
elle-même sur les échafaudages. Puis, les Ursulines
ayant désigné la Vierge Marie comme la première et
principale Supérieure de la communauté, la Vierge
favorisa Sœur Marie de l'Incarnation de sa fidèle et
sensible présence du début à la fin de l'entreprise.
Bientôt, le pensionnat déborda d'enfants et d'autres
ursulines arriveront…
Malgré son âge: 40 ans, Sœur Marie de l'Incarnation
étudia les langues indiennes extrêmement difficiles, et
rédigea un dictionnaire algonquin-français, ainsi qu'un
dictionnaire et un catéchisme iroquois. Son travail
préféré était d'enseigner les petites Indiennes qu'elle
appelait les "délices de son cœur" et "les
plus beaux joyaux de sa couronne." Force est de
constater que Marie de l'Incarnation, contemplative par
sa vocation de religieuse cloîtrée consacrée à une vie
de prière, sut être aussi très active et apôtre, quoique
soumise aux contraintes de l'insécurité qui régnait à
cette époque au Canada. Elle resta toujours une femme
d'action douée d'un grand sens pratique.
En 1651, après un terrible incendie qui détruisit leur
monastère, les Ursulines, furent accueillies dans une
petite maison que Madame de la Peltrie s'était fait
construire à proximité du monastère; elles purent, avec
le secours des colons, reconstruire leur couvent et leur
école. Et sous la direction de Marie de l'Incarnation,
le monastère se releva des ruines.
Quelle intelligence chez Marie de l'Incarnation, qui
assuma de multiples responsabilités: supérieure,
assistante, économe de la communauté et formatrice des
novices! Elle réussit à maîtriser quatre langues
autochtones, à composer des dictionnaires, à participer
à l'éducation des enfants et des adultes tout en
effectuant des tâches domestiques. Elle entretenait
également une correspondance d'affaires et d'amitié avec
la France. Ses lettres constituent une mine
d'informations sur l'histoire des premières décennies de
la colonie. Elle commenta notamment les guerres
franco-iroquoises et la destruction de la Huronnie,
territoire des Hurons.
Mère très aimante, Marie
de l'Incarnation écrivait régulièrement à son fils
Claude devenu moine bénédictin. Elle répondait toujours
avec clarté à ses questions de moine théologien. En
1654, à la demande insistante de Claude, elle commença à
écrire l'histoire des grâces de Dieu dans sa vie.
Certes, un océan séparait la mère et le fils, mais
l'amour du Seigneur les gardait intimement unis. Après
la mort de sa mère, Claude, prieur de son abbaye
bénédictine écrivit:
"Dieu n'a pas voulu que
l'amour seul ait séparé son âme de son corps; il y a
voulu joindre la souffrance, afin qu'elle mourût, à
l'imitation de son Époux, d'amour et de douleur tout
ensemble."
Malade depuis déjà longtemps, Marie de l'Incarnation
reçut le sacrement des malades, demanda pardon à son
entourage et remercia ses Sœurs de leur charité à son
égard. Elle les encouragea à rester fidèles à leur
vocation contemplative et missionnaire. Puis, le 30
avril 1672, elle rendit son âme à Dieu; elle avait 72
ans.
Marie de l'Incarnation, qui avait été surnommée
la Thérèse
de la Nouvelle-France,
par Bossuet, fut béatifiée, le 22 juin 1980 pape le pape
Jean-Paul II. Le pape François la canonisa le 3 avril
2014.
Nous devons ajouter que les ursulines et les
Hospitalières, une communauté voisine des Ursulines,
surent ensemble soigner d'un même cœur aussi bien les
Français que les amérindiens. Deux communautés de
religieuses cloîtrées qui surent poser les fondations
d'une Église et d'un pays tout neuf: le Canada.
Paulette Leblanc |
