|
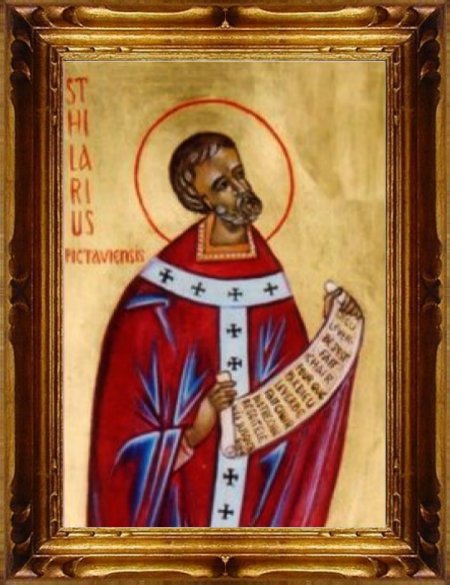 |
Aujourd'hui 13 janvier, nous allons parler de saint
Hilaire de Poitiers. Mais avant de découvrir sa vie,
nous voulons connaître la signification de ce nom
bizarre. Hilaire, on s'en doute un peu, vient du mot
"hilarité", parce que saint Hilaire aurait servi
Dieu avec un cœur plein de joie. Hilaire pourrait venir
aussi de
altus,
qui signifie: haut, ou élevé, et d'arès
qui veut dire: vertu. En effet, Hilaire aurait été élevé
en science et en vertu, durant toute sa vie. Hilaire
pourrait aussi être un dérivé de
hylè,
qui veut dire qui fut obscur; en effet, dans les œuvres
si profondes de saint Hilaire, il y a parfois de grandes
obscurités pour les non initiés.
Hilaire est issu de l'aristocratie gallo-romaine. Il
naquit vers les années 310 ou 315, à Lemonum, chef-lieu
de la cité des Pictons. Lemonum est l'ancien nom de
Poitiers. La famille, païenne, riche et noble, donna une
excellente éducation à Hilaire, jeune homme très doué
pour les études. Cependant Hilaire, vivant dans des
milieux païens, était très tourmenté par des questions,
devenues très cou-rantes aujourd'hui: quel sens donner à
la vie? Et encore: où se trouve le bonheur pour l'homme?
D'où la question fondamentale: à quoi sert-il d'exister
si l'on doit mourir? Question qui aboutit inévitablement
sur le mystère: y a-t-il un dieu?
Hilaire lisait beaucoup afin de trouver, chez les
philosophes anciens, la réponse à ses angoisses. Mais
ses lectures le décevaient toujours, jusqu'au jour où il
découvrit cette phrase de la Bible: "Je suis celui
qui est." Hilaire s'enthou-siasma, mais la mort
restait toujours pour lui une idée insupportable. Il
découvrit enfin l'Évangile de Saint Jean qui lui révéla
l'Incarnation et la Résurrection. Hilaire avait trente
ans; il demanda le baptême. Nous sommes aux alentours de
345.
Hilaire était marié et il avait une fille, Apia ou Afra.
Cependant il était devenu un très bon théologien, et sa
famille, au cœur de Poitiers, était le refuge de ceux
qui se trouvaient dans l'affliction. Vers 351-352,
l'évêque Paixent de l'Église de Poitiers mourut. Hilaire
qui jouissait d'un grand prestige, car on le savait
remarquable théologien, fut choisi par acclamations
comme son successeur. Hilaire accepta dans un esprit de
service ses nouvelles responsabilités. Et il appliquera
durant toute sa vie ses propres paroles: "L'évêque
est placé à la tête de la maison pour veiller aux
besoins et aux intérêts du peuple qui lui est confié"
et "L'évêque ne remplit son ministère que s'il
fortifie ce qui est faible par un enseignement à la fois
authentique et adapté, s'il consolide ce qui tombe en
ruine, s'il redresse celui qui s'égare, s'il dispense le
verbe de vie à la famille qu'il a à nourrir de la
nourriture éternelle". D'ailleurs saint Paul,
parlant de l'évêque, n'avait-il pas écrit, dans sa
première lettre à Tite (1 Ti 1, 1 à 9): "Il doit être
sobre, fuir les querelles, être un bon époux, un bon
père de famille. S'il ne présente pas de telles qualités
dans son ménage il est probable qu'il ne les présentera
pas non plus dans l'administration de l'Église."
Dès
lors la vie d'Hilaire va basculer. Son épiscopat
commence dans une période de grand trouble pour
l'Église: le développement de l'arianisme dans tout
l'Occident. Niant la divinité de Jésus-Christ les
disciples d'Arius faisaient de plus en plus de
prosélytisme. Par ailleurs, la santé du pape Jules 1er
déclinait. Après sa mort, Jules 1er
sera remplacé par des papes ariens; puis, en 366 il y
au-ra deux papes: Ursinus, continuant l'hérésie arienne
et Damase 1er, catholique-orthodoxe.
Hilaire, devenu évêque de Poitiers, rencontra très
rapidement saint Athanase d'Alexandrie, alors exilé en
Gaule à cause de l'hérésie arienne. Hilaire, combattant
à son tour cette hérésie, sera, sur ordre de l'empereur
Constance, exilé en Phrygie, en Turquie, où il
découvrira la théologie grecque et deviendra de tous les
Pères latins de l'Église, celui dont la pensée sera la
plus proche des Pères Grecs. Curieusement, le
Commentaire sur l'Évangile de Matthieu, pre-mière
œuvre d'Hilaire, évêque soucieux de l'instruction de son
peuple, montre toutefois que son auteur ne connaissait
pas la tradition orientale, et même qu'il ignorait les
textes du Concile de Nicée qu'il ne découvrit qu'en 354.
Dès 355, alors que l'arianisme s'étendait dans toute la
Gaule, Hilaire s’opposa à cette théologie et écrivit
son œuvre magistrale, son "Traité sur la Trinité."
Parlons un peu des œuvres de saint Hilaire de Poitiers
Presque tous les écrits d'Hilaire ont été conservés:
écrits exégétiques, traités théologiques et compositions
liturgiques, en particulier des hymnes. Nous venons
d'entendre que saint Hilaire avait rédigé un
Commentaire sur l’évangile de Matthieu. Ce document
est la première œuvre exégétique latine qui nous soit
parvenue.
Abordons maintenant la principale œuvre écrite de saint
Hilaire De Trinitate. Ce traité, comprenant douze
livres, fut composé pendant son exil en Phrygie. Hilaire
y défend la consubstantialité du Fils avec le
Père, contre les ariens qui niaient la divinité du
Christ, et contre la doctrine professée par Sabellius,
originaire de Lybie. La doctrine de Sabellius, le
modalisme, ne distinguait pas le Père du Fils. La
théologie d'Hilaire, première synthèse doctrinale écrite
en latin, eut une influence profonde durant tout le
siècle suivant. Saint augustin reprendra cette théologie
de saint Hilaire, mais la complétera en définissant la
divinité du Saint-Esprit.
S'appuyant sur les écrits d'Origène dont il tirera des
conclusions simples, et sur le texte grec des Écritures,
appelé la Septante, Hilaire rédigera de précieux
commentaires bibliques. Dans son Traité des Mystères,
Hilaire montre comment les événements rapportés dans la
Bible concernent le Christ. Enfin, ses Hymnes,
récemment redécouvertes, nous font entrer dans une
poésie inspirée à la fois des modèles classiques (latins
et grecs) et bibliques (psaumes alphabétiques).
Hilaire revint de son exil en d'Orient vers 361 et
rentré à Poitiers, il put y finir ses jours et y mourir
vers 367, soit le 1er
novembre 367, soit le 1er
janvier 368. Il a été élevé au rang de docteur de
l'Église en 1851, par le pape Pie IX. Il est fêté le 13
janvier.
Voici maintenant quelques petits compléments, pour
édifier, et nous distraire.
Saint Hilaire fit plusieurs miracles qui
enthousiasmèrent le peuple. En voici un: en l'an 360,
lorsqu'Hilaire revint dans les Gaules, à Poitiers, la
population lui fit un triomphe. Un jour, on lui apporta
un enfant mort sans baptême. Hilaire se mit à genoux et
dit qu'il ne se relèverait qu'après l'enfant... L'enfant
revint à la vie et fut baptisé au nom du Père et du Fils
et de l'Esprit-Saint.
On
raconte une autre chose, digne d'admiration: Apia, la
fille d'Hilaire, voulait se marier. Son père Hilaire
l’instruisit longuement et l’affermit dans le dessein de
sauvegarder sa virginité. Au moment où il la vit bien
résolue, craignant qu'elle ne variât dans sa conduite,
Hilaire pria le Seigneur avec grande instance de la
retirer de la vie de ce monde: et il en fut ainsi, car
peu de jours après, elle trépassa dans le Seigneur. Son
père, l'évêque, l’ensevelit de ses propres mains; en
voyant cela, la mère d'Apia pria l’évêque de lui obtenir
ce qu'il avait obtenu pour sa fille; et Hilaire le fit
encore, et, par sa prière, il l’envoya par avance dans
le royaume du ciel.
Saint Hilaire, surnommé par saint Jérôme, le "Rhône
de l'éloquence latine et la trompette des Latins face
aux Ariens" est un des plus grands théologiens du
haut Moyen-Âge. Contemporain de Saint Athanase et de
Saint Basile, Saint Hilaire mena le même combat qu'eux
pour la défense de la vraie
Foi. On l'a surnommé "l'Athanase d'occident".
À Poitiers, malgré son épuisement, Hilaire rédigea son
ouvrage, "contre Auxen-ce" dans lequel il
dénonçait avec force les empiétements du pouvoir
impérial sur les affaires religieuses et où il précisait
les conditions réelles de l'unité des chrétiens; il
aimait dire: "Les oreilles du peuple chrétien sont
plus saintes que le cœur de leurs évêques".
Voici maintenant un texte dans lequel Hilaire essaie
d'expliquer la Sainte Trinité. Il prie Dieu et dit: "Je
t’en prie, conserve intacte la ferveur de ma foi et
jusqu’à mon dernier souffle
donne-moi de conformer ma voix à ma conviction profonde.
Oui, que je garde toujours ce que j’ai affirmé dans le
symbole proclamé lors de ma nouvelle naissance, lorsque
j’ai été baptisé dans le Père, le Fils et l’Esprit
Saint!"
Il
écrivit aussi, s'adressant au Père: "Quant à moi,
j'en ai conscience: le devoir principal de ma vie est de
m'offrir à Toi, Dieu, Père Tout-Puissant, pour que tout
en moi, paroles et pensées, parlent de Toi. Oui, la plus
grande récom-pense que puisse m'apporter l'usage de la
parole dont tu m'as gratifié, c'est de l'employer à te
servir, en proclamant ce que Tu es, c'est-à-dire le Père
de l'Unique-Engendré, et en le démontrant à un monde
qu'il ignore et à l'hérétique qui le nie. Oui, vraiment,
c'est là, je le déclare, mon seul désir! Toutefois j'ai
grand besoin d'implorer dans la prière la grâce de ton
secours et de la miséricorde, pour que le souffle de ton
Esprit gonfle les voiles de notre foi, tendues pour Toi;
qu'il nous fasse avancer dans ce voyage qu'est l'en-seignement
que nous commençons de donner ici. Accorde-nous donc de
don-ner aux mots leur véritable sens, prodigue la
lumière à notre esprit, la beauté de l'expression à
notre style et établis note foi dans la vérité.
Accorde-nous de dire ce que nous croyons. Selon le
devoir qui nous incombe, après avoir appris des
prophètes et des apôtres que Tu es un seul Dieu et qu'il
y a un seul Sei-gneur Jésus-Christ, donne-nous de Te
célébrer, et, contre les négations héré-tiques,
donne-nous de le proclamer, Lui, Jésus-Christ, Dieu et
non faux Dieu." (Extrait de DE TRINITATÉ, l, 6)
Mais
Hilaire voulait aussi montrer combien la Trinité et
l'Eucharistie sont unies. Il écrivit, au sujet du
mystère Trinitaire et de l'union Eucharistique:
"Eucharistie nourriture céleste et lien d'unité de la
communauté chrétienne avec le Christ! Nier l'unité
naturelle du Père et du Fils c'est nier la réalité de la
communion eucharistique au Christ. La communion
Eucharistique pour saint Hilaire, débouche dans
le mystère de l'intimité trinitaire à laquelle l'Eucha-ristie
nous fait participer, dont elle nous révèle la vérité et
dont elle permet la confession. Si donc le Christ a
vraiment assumé la chair de notre corps, si cet homme,
né de Marie, est vraiment le Christ, nous mangeons la
chair de son corps dans le sacrement, et par-là, nous
sommes un, puisque le Père est en lui et que lui est en
nous." (DE TRINITATE, 8/16 6)
Paulette Leblanc |
