|
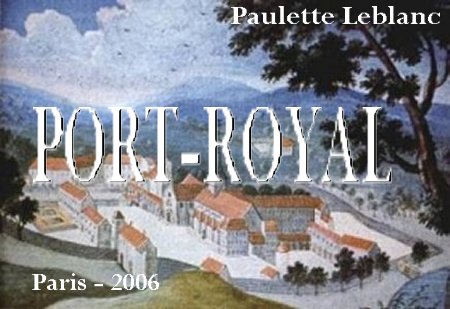

Chapitre 1
Jean
Duvergier de Hauranne
abbé de Saint-Cyran
(1581-1643)
Jean Duvergier de Hauranne, qui devint l’abbé de
Saint Cyran, est surtout connu comme celui qui introduisit en France la doctrine
janséniste.
Jean Duvergier de Hauranne naquit à Bayonne en
1581. Il fit une partie de ses études à l’université de
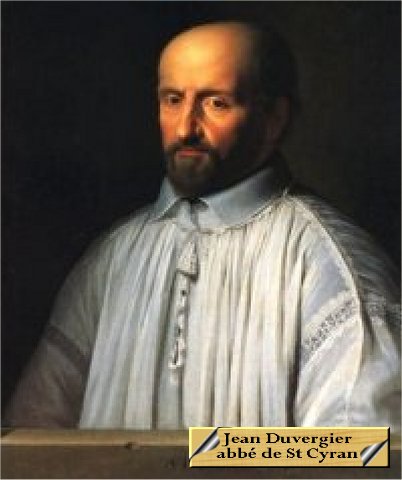 Louvain,
et rencontra Cornelius Jansen en 1609, à Paris. Les deux hommes se retirèrent
ensuite à Bayonne pour étudier la patristique, et, en particulier, les oeuvres
Saint Augustin. Plus tard, Jansen s’en retourna à Louvain, et Saint-Cyran
correspondit régulièrement avec lui. Ce serait même lui qui aurait invité Jansen
à préparer son livre L’Augustinus, lequel deviendra le fondement de la
doctrine janséniste. Louvain,
et rencontra Cornelius Jansen en 1609, à Paris. Les deux hommes se retirèrent
ensuite à Bayonne pour étudier la patristique, et, en particulier, les oeuvres
Saint Augustin. Plus tard, Jansen s’en retourna à Louvain, et Saint-Cyran
correspondit régulièrement avec lui. Ce serait même lui qui aurait invité Jansen
à préparer son livre L’Augustinus, lequel deviendra le fondement de la
doctrine janséniste.
Devenu abbé de Saint-Cyran en 1620, Duvergier de
Hauranne se lia d’amitié avec le cardinal de Bérulle, fondateur de l’Oratoire,
en France, et fréquenta le milieu dévôt de l’époque. Comme Bérulle, l’abbé de
Saint-Cyran avait un vrai désir travailler à la réforme de l’Église et à la
conversion profonde des chrétiens de son époque.
En 1633, l’Abbé de Saint-Cyran, disciple passionné
de Saint Augustin, fut nommé directeur spirituel et confesseur du couvent de
Port-Royal. C’est sous sa direction, jusqu’en 1636, que le monastère devint le
centre principal, en France, de ce que l’on appellera plus tard le jansénisme.
Depuis la mort de Bérulle en 1629, Saint-Cyran
dirigeait le “parti dévot”[1]
appuyé par le Parlement. Or, on se souvient que Bérulle, à la fin de sa vie,
s’était trouvé en désaccord avec la politique de Richelieu. Moins diplomate que
Bérulle, Saint-Cyran s’attira les foudres du puissant ministre. Son ami Jansen
était d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage assez politique, Mars gallicus
dirigé contre Richelieu. Soupçonné de comploter contre son pays, suspecté quant
à son orthodoxie, et insoumis à Richelieu, Saint-Cyran fut arrêté et mis en
prison à Vincennes en 1638. Il n'en sortit qu'en 1643, après la mort de
Richelieu, et mourut huit mois plus tard, à Paris, en octobre 1643.
Il convient de noter ici que Saint-Cyran se
montrait également un farouche adversaire des jésuites qu’il estimait trop liés
à Rome et trop laxistes sur le plan moral.
Le rayonnement spirituel de Saint-Cyran ne
s’éteignit pas pendant son incarcération: depuis sa cellule, il continuait sa
direction spirituelle au moyen d'une abondante correspondance. Après la mort de
Saint-Cyran, considéré comme père fondateur, en France, de l’augustinisme, et
vénéré comme un martyr par ses amis, la cause janséniste, fut défendue par
Antoine Arnauld, le successeur qu'il s'était désigné.
Grâce à son autorité et au soutien de ses
nombreuses relations, Jean Duvergier de Hauranne avait eu une influence
considérable dans la France de la première moitié du XVIIe siècle. Des gens
venus de tous les milieux: membres du clergé, de la noblesse, et des milieux
parlementaires, s’étaient rendus à Port-Royal pour entendre les sermons et les
conseils de ce “maître en humanité et guide pour la vie intérieure”.
Dès 1633, toute la famille Arnauld, et pas
seulement la Mère Angélique et les religieuses de Port-Royal, fut conquise par
le charisme exceptionnel de l'abbé de Saint-Cyran, et se trouva, insensiblement,
engagée dans la défense de la grande cause augustinienne. C’est ainsi que
Saint-Cyran devint un ami très cher de Robert d'Andilly, l'aîné de la famille
Arnauld, qu'il engagea à traduire saint Augustin et à composer de la poésie
religieuse. Robert d'Andilly, après la mort de son directeur, publiera aussi sa
correspondance.
Mais c'est surtout sur le cadet de la famille
Arnauld que Saint-Cyran faisait reposer ses plus grands espoirs: Antoine, qui
deviendra bientôt "le Grand Arnauld", était un jeune théologien de la Sorbonne,
tout acquis à la cause augustinienne, et promis à un brillant avenir. À la
demande de Saint-Cyran, il publia un ouvrage, la Fréquente communion
(1643), où il soutenait, contre les jésuites, que communier était une chose
grave, qui ne se pouvait faire à la légère, et qui demandait un minimum de
préparation. Or, Antoine Arnauld appuyait son argumentation sur ses
impressionnantes connaissances patristiques. En conséquence, il fallait
communier le moins souvent possible, et hésiter à recevoir les sacrements.
Comme il fallait s’y attendre, l'Augustinus
et La Fréquente communion furent violemment attaqués, en
particulier par les jésuites, qui accusèrent les amis de Port-Royal de
"jansénisme". Ce mot n’était alors qu’un quolibet utilisé pour désigner les
amis de Port-Royal qui prétendaient pourtant n’être que des disciples de
Saint-Augustin. Ce quolibet, à l’époque, était employé exclusivement par les
adversaires des jansénistes, et contre les jansénistes. Il voulait signifier que
ces catholiques trop rigoristes n’étaient en fait que des hérétiques, sectateurs
de l'évêque d'Ypres, Corneille Jansen, et pas seulement des adeptes de la
doctrine de Saint Augustin.
Lorsqu’on se penche un peu longuement sur la vie
de l’abbé de Saint-cyran, il ne semble pas, tout d’abord, que cet homme ait été
un “mauvais homme”, un hérétique, un véritable sectaire. Il semble même que,
outre les religieuses de Port-Royal, de nombreuses âmes soient venues chercher
Dieu et du réconfort auprès de lui. Pourtant, c’est bien lui qui a introduit le
jansénisme à Port-Royal, mais en toute bonne foi semble-t-il. Et c’est là que
nous avons du mal à comprendre.
Nous comprenons mal, car Saint-Cyran, suivant en
cela son ami Jansen, se référait surtout à Saint Augustin, docteur de l’Église.
Alors? Comment conclure un chapître, même court, consacré à Saint-Cyran? Comment
exprimer cette sorte de malaise qui nous étreint, manifestation de sentiments
contradictoires? Oui, comment conclure?
On est en droit de se demander: Jansen et
Saint-Cyran ont-ils bien interprêté Saint Augustin? Ou bien encore, la lecture
qu’ils firent de ses œuvres a-t-elle été complète? Comment des hommes, qui
cherchaient vraiment Dieu, ont-ils pu se focaliser ainsi sur quelques points de
doctrine, qui avaient déjà, longtemps auparavant, fait naître bien des querelles
dans l’Église, et à propos desquels l’Église avait imposé le silence? Enfin, il
faut ajouter que les points litigieux, concernant la grâce, le libre arbitre ou
la prédestination, ne constituent pas l’essentiel de la pensée de Saint
Augustin...
Il y a plus. Saint-Cyran fut très lié à Bérulle.
Il a inévitablement connu Charles de Condren, le successeur de
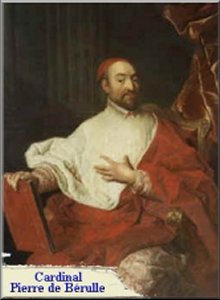 Bérulle. Il n’a
pas pu ne pas entendre parler du saint évêque de Cahors, Alain de Solminihac, de
Jean Eudes, de Jean-Jacques Olier, fondateur des Sulpiciens, et même de Gaston
de Renty ou de la Mère Mechtilde du Saint-Sacrement. Tous ces saints qui ont
“fait” l’École Française de spiritualité étaient ses contemporains. Alors?... Bérulle. Il n’a
pas pu ne pas entendre parler du saint évêque de Cahors, Alain de Solminihac, de
Jean Eudes, de Jean-Jacques Olier, fondateur des Sulpiciens, et même de Gaston
de Renty ou de la Mère Mechtilde du Saint-Sacrement. Tous ces saints qui ont
“fait” l’École Française de spiritualité étaient ses contemporains. Alors?...
Alors, pourquoi, ayant cheminé un temps avec eux,
fut-il si différent de ses contemporains, et comment a-t-il pu introduire ce que
l’on appela l’hérésie janséniste? Sa bonne foi aurait-elle été emporté par un
orgueil sournois et dangereux?
Il est un passage de l’Évangile de Saint Jean (3,
16-21) qui donne peut-être une réponse.
“Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils
unique: ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la
vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé... Mais celui qui agit selon
la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des
œuvres de Dieu.”
Jansen et Saint-Cyran auraient-ils oublié de lire
l’Évangile? En se cantonnant à la seule méditation de Saint Augustin, n’ont-ils
pas oublié l’amour et la Miséricorde du Seigneur, pour tous les hommes? Et si la
Miséricorde de Dieu est pour tous les hommes, c’est que Dieu ne “s’amuse” pas à
les créer pour en damner ensuite un grand nombre.
Et puis, nous savons bien que Jésus-Christ est
mort pour tous les hommes pécheurs, pour sauver tous les hommes dont la liberté,
hélas! peut faillir. Et c’est Jésus Lui-même qui, dès le XVIIe siècle, puis
davantage au XVIIe, apporta le remède contre le jansénisme. Jésus, pour redonner
espoir aux désespérés qui pouvaient se croire prédestinés à la damnation
éternelle, Jésus nous révélait, à la même époque, d’abord par une petite
carmélite du Carmel de Dijon, Sœur Marguerite du Saint-Sacrement, puis à travers
Jean Eudes et Marguerite-Marie Alacoque, tout l’amour de son Sacré-Cœur
miséricordieux, amour exprimé par son Incarnation et son enfance, sa vie au
milieu de nous, sa mort et sa Résurrection.
Le jansénisme mourra, mais l’amour de Dieu pour
tous les hommes, et sa miséricorde sont éternels. Cela, c’est le Sacré-Cœur
lui-même qui nous l’a enseigné.
[1] Curieusement,
à cette époque, c’est le groupe des partisans de Saint-Cyran qui fut
appelé le “parti dévot”.


|
