La France en 1871
C’est l’hiver, c’est la guerre. Les
troupes de Guillaume 1er, roi de Prusse, ne cessent de l’emporter
sur celles de Napoléon III ; le 19 septembre 1870, elles ont
commencé le siège de Paris ; le 12 janvier 1871, elles sont entrées
au Mans, progressant vers l’Ouest, elles sont aussi entrées en
Mayenne.
Le 17 janvier, une pointe avancée de
l’armée prussienne arrive aux portes de Laval. Parmi les soldats
français règnent le désordre et la panique. Dans les campagnes, les
paysans cachent ce qu’ils ont : argent, linge et nourriture. Aux
misères de la guerre s’ajoute une épidémie de typhoïde et de
variole.
Pontmain est touché. Sur une
population d’environ cinq cents habitants, la paroisse a vu partir
trente-huit jeunes appelés sous les drapeaux. On était sans
nouvelles. Tout allait mal. Les paroissiens disaient : « On a beau
prier, le bon Dieu ne nous écoute pas ». Le dimanche 15 janvier,
après les vêpres, le curé avait entonné comme de coutume le cantique
de Saint-Brieuc :
Mère de l’Espérance
Dont le nom est si doux
Protégez notre France,
Priez, priez pour nous.
Il s’était retrouvé seul à chanter. Se
retournant, il exhorta les paroissiens. Ils chantèrent, mais en
pleurant.
Le mardi 17 janvier 1871, on demeurait
dans l’angoisse et la désolation. Il fait froid. La neige couvre le
sol et les toits. Le ciel est pur quand vient la nuit toute
constellée.
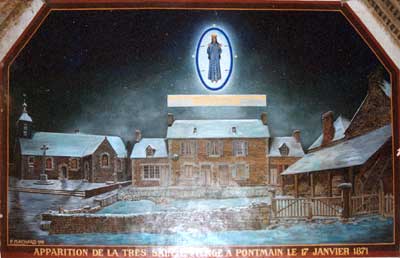
L’abbé Guérin, curé de Pontmain
Ces quelques lignes ne sont pas une
biographie de Michel Guérin, mais l’esquisse d’un portrait d’un
prêtre de chez nous. Par sa foi, sa prière confiante et son amour du
prochain, il a transformé une paroisse qu’il a créée et portée en
son cœur jusqu’à son dernier souffle : « Pour vous, restez de bons
chrétiens… Oh ! oui, que la paroisse reste toujours ce qu’elle est »
furent ses dernières paroles le 29 mai 1872.
Après la tourmente révolutionnaire,
les paroisses de France se trouvent en face de nombreuses
difficultés : églises ruinées, mobilier détruit ou délabré. Telle
est la situation de la petite chapelle rurale de Pontmain qui
deviendra l’église : la toiture laisse passer l’eau, l’autel et les
bancs sont vermoulus, il n’y a plus ni linges, ni ornements, ni
vases sacrés.
C’est alors qu’arrive au soir du 24
novembre 1836, l’abbé Michel Guérin, vicaire à Saint-Ellier du
Maine. Il connaît la misère de Pontmain. Il est allé au Mans,
supplier son Evêque de lui confier ce petit hameau perdu au milieu
des champs. N’ayant pas de presbytère, il va se contenter d’une
chambre meublée dans une modeste chaumière. Voilà ce qu’il écrira de
ces débuts à son Evêque : « Oui ! Monseigneur, j’ai dit la messe sur
une pierre sacrée posée sur des planches rapprochées les unes des
autres ; mes confrères et moi avons prêché de dessus un établi »
(lettre du 15 octobre 1844).
Les jours qui suivent son arrivée, il
se met au travail. Avec ses nouveaux paroissiens, il restaure la
toiture, refait des bancs neufs. Les femmes préparent du linge
d’autel et des ornements. De nombreuses réalisations viendront par
la suite : tracé de nouvelles routes, érection de l’église en
succursale, puis en paroisse, construction d’une école. Il fera même
ouvrir un bureau de tabac (sans doute pour trouver à proximité son
tabac à priser). Il a le sens du pratique. Il se donne à tous : en
s’occupant des intérêts matériels de son petit peuple, il le gagne à
Jésus-Christ. Très vite il fait de Pontmain une paroisse vivante et
priante.
Son ministère repose sur la prière et
une grande piété mariale, il intronise une statuette de la Sainte
Vierge dans tous les foyers. C’est à partir de ce moment-là que dans
chaque famille, on prie le chapelet tous les jours. Il fait ériger
et bénit de nombreuses croix au bord des chemins. Il fait placer la
statue de Marie dans le clocher. A partir du 8 décembre 1854
(définition du Dogme de l’Immaculée Conception), quatre bougies sont
allumées sur l’autel de la Vierge à tous les offices de la paroisse.
En 1860, il fait peindre la voûte de l’église en bleu ciel avec un
semis d’étoiles d’or.
L’histoire de Michel Guérin n’est pas
banale. Celui que l’on surnommait alors un peu malicieusement « le
curé aux bonnes Vierges » a su ― en son temps ― marquer profondément
ce petit coin du Bocage mayennais que Marie « la Madone aux étoiles
» allait venir visiter le 17 janvier 1871.
Les témoins de l’apparition
Victoire Barbedette avait perdu son
premier mari Augustin Friteau avec trois petites filles en 1856 lors
d’une épidémie de typhoïde. Restée seule avec son fils Auguste, elle
s’était remariée en 1857 avec César Barbedette dit « Bériot ». De ce
mariage vont naître deux garçons.
Eugène est né à Pontmain le 4 novembre
1858. Très tôt, il fut, comme son frère, initié à la prière.
N’oublions pas qu’à Pontmain, on priait le chapelet tous les jours
dans toutes les familles et cela depuis l’arrivée de l’abbé Michel
Guérin. Le travail manuel faisait aussi partie du quotidien.
« Aussitôt sortis de l’école, toutes
sortes de petits travaux nous attendaient à la maison. Il fallait
tourner le rouet de la mère et de la domestique, effilocher les
vieux chiffons de laine, piler les ajoncs dans la grange, couper en
tranches les betteraves et les carottes pour la nourriture des
animaux. Je me souviens que ce travail était assez dur… Il n’y avait
donc jamais pour nous un instant de paresse » (mots d’Eugène).
Le matin du 17 janvier 1871, après le
travail avec le père, il fallait bien remplacer le frère aîné
Auguste parti à la guerre ; il était allé à l’église prier et servir
la messe avant d’aller à l’école. Le soir, il se retrouvait à la
grange pour le travail quand sorti dehors « voir le temps » il vit
le premier la belle Dame.
Joseph est né le 20 novembre 1860. Il
était d’un caractère plus enjoué que son frère, plus jovial. Lui
aussi comme son frère avait été formé par Victoire à la prière et au
travail. L’éducation « selon Victoire » était celle que l’on
retrouvait dans toutes les familles de l’époque. C’était la mère qui
était investie de la charge de l’éducation. Non point que le père
s’en désintéressât, mais il était pris par le travail des champs,
tandis que la mère se tenait à la maison ; il n’intervient qu’en
dernier ressort pour les cas jugés graves par la mère : « Je vais le
dire à ton père ».
La sanction était la plupart du temps
une « tok » ; les gifles c’étaient pour les plus petits rebelles de
la ville. A la campagne, on donne une « tok ». Le mot exprime
parfaitement ce qu’il représente. C’était le bruit que le geste
produisait sur la joue du récalcitrant. Victoire, disait-on, avait
la « tok » facile, et c’était musclé.
Joseph avait donc dormi à la grange
avec Eugène comme ils étaient habitués à le faire. Réveillés de
bonne heure par leur père, ils avaient travaillé, puis mangé la
soupe du matin avant d’aller à l’église où ils vont faire la grande
prière du matin, puis le chemin de croix (c’était une promesse faite
à Auguste pour qu’il revienne sain et sauf de la guerre) avant de
servir la messe.
« Oh ! la belle Dame ! Qu’elle est
belle ! ». C’est par cette exclamation que Joseph sorti de la grange
un peu après son frère va saluer l’apparition.
Jeanne-Marie est née à Gosné
(Ille-et-Vilaine) au village de Louvel le 12 septembre 1861. Elle
était la fille unique de François Lebossé et de Jeanne-Marie
Garancher. Dès le lendemain de sa naissance, elle avait été baptisée
à l’église de Gosné par l’abbé Beaulieu, recteur.
Elle écrira plus tard : « Depuis l’âge
de deux ans, à la mort de mon père, ma mère étant tombée paralysée,
j’ai été recueillie par ma tante Supérieure des Sœurs Adoratrices de
la Justice de Dieu, qui tenaient l’école à Pontmain » (12 décembre
1920).
Voilà donc Jeanne-Marie arrivée très
tôt à Pontmain près de la tante Perrine Lebossé, en religion Sœur
Marie-Timothée de la Croix née elle-même à Laignelet
(Ille-et-Vilaine). Directrice de l’école, elle donne aussi des soins
à domicile.
Pour Jeanne-Marie, la mort de son père
et la maladie de sa mère qui entraînent la séparation sont sans nul
doute une épreuve terrible qui la marque dès sa plus tendre enfance
et que l’affection de la tante religieuse ― malgré tous ses
efforts ― ne pourra compenser.
Se trouvant sur place, Jeanne-Marie va
entrer très tôt à l’école, ce que dénoterait son esprit éveillé.
Le soir du 17 janvier, elle va suivre
Sœur Vitaline avec les deux autres pensionnaires et elle va être
témoin de tout ce qui se passe ce soir-là au-dessus de la maison
d’Augustin Guidecoq.
On sait peu de choses de l’enfance de
Françoise Richer. Elle était née en 1860.
Pensionnaire à l’école de Pontmain,
elle vit là avec les religieuses : Sœur Marie-Timothée, Sœur
Vitaline et Sœur Marie-Edouard et deux autres petites pensionnaires
: Augustine Mouton, âgée de 13 ans, et Jeanne-Marie Lebossé (9 ans).
Une première fois, Victoire Barbedette
était venue demander à Sœur Vitaline (Sœur Marie-Timothée était ce
soir-là à sa communauté de Rillé Fougères) : « Ma Sœur,
voudriez-vous venir chez nous ? Les garçons disent qu’ils voient
quelque chose, mais nous on ne voit rien ».
Sœur Vitaline ne vit rien non plus, à
l’exception des trois étoiles, mais fit cette réflexion judicieuse :
« Si ce sont les enfants qui voient, c’est qu’ils en sont plus
dignes que nous ».
De retour à l’école, Sœur Vitaline
dira aux petites filles : « Petites filles, venez donc par là,
Victoire a quelque chose à vous montrer ».
Les enfants hésitent. Françoise a peur
de la nuit. Pourtant, c’est elle qui va voir la première. Arrivée au
coin de la maison du cordonnier Rousseau, elle s’écrie : « Moi je
vois bien quelque chose sur la maison Guidecoq, mais je ne sais pas
ce que c’est ».
Elle fait les quelques pas qui la
séparent de la grange avant d’écrier en même temps que Jeanne-Marie
: « Oh ! la belle Dame » ! »
Françoise et Jeanne-Marie décrivent
alors cette belle Dame, tout comme les garçons l’avaient déjà fait
auparavant.
Le jour où le ciel s’est ouvert
Pontmain, le 17 janvier
1871. Il fait nuit. Il fait froid. La France est en guerre. Paris
est assiégé. Les Prussiens, vainqueurs, sont aux portes de Laval. A
Pontmain, c’est l’angoisse : on est sans nouvelles des 38 jeunes
mobilisés. Ce soir-là, Eugène Barbedette aide son père à piler les
ajoncs dans la grange. Son jeune frère, Joseph, est là aussi. Eugène
sort « voir le temps ».
Une belle dame…
C’est alors qu’il voit
au-dessus de la maison d’en face une belle dame à la robe constellée
d’étoiles qui le regarde en souriant et en tendant les mains en
avant. Les villageois accourent vers la grange.
D’autres enfants voient
à leur tour. Un ovale bleu avec quatre bougies éteintes vient
entourer la Belle Dame.
Autour de Monsieur le
Curé et des religieuses de l’école s’organise une veillée de prière.
« Priez mes enfants »
On récite le chapelet,
puis le Magnificat, quand une banderole se déroule entre l’ovale et
le toit de la maison.
Lettre
après lettre, un message s’inscrit, aussitôt épelé et lu par les
enfants, pendant que la foule chante les litanies de la Sainte
Vierge, l’Inviolata et le
Salve Regina.
MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS
MON FILS SE LAISSE TOUCHER
La ferveur grandit et les enfants
manifestent leur joie : « Oh ! Qu’elle est belle ! ». On chante
Mère de l’Espérance.
Soudain les enfants deviennent tout
tristes alors que le visage de Marie est empreint lui aussi d’une
profonde tristesse.
Une croix rouge apparaît devant elle
portant Jésus tout sanglant. Au sommet de la Croix, sur une traverse
blanche, s’écrit en rouge le nom de Celui qui est là : JESUS-CHRIST.
Marie saisit le crucifix à deux mains et le présente aux enfants
tandis qu’une petite étoile allume les quatre bougies de l’ovale. On
prie en silence. On chante Ave Maris stella. Le crucifix
rouge disparaît. Marie reprend l’attitude du début, les mains
tendues dans un geste d’accueil. Une petite croix blanche apparaît
sur chacune de ses épaules. Tout le monde s’agenouille dans la neige
pour la prière du soir. Bientôt un grand voile blanc se déroule à
partir des pieds et peu à peu la recouvre entièrement. «Tout est
fini» disent les enfants. Chacun retourne chez soi, le cœur apaisé.
Onze jours plus tard l’armistice est signé. Les Prussiens n’étaient
pas entrés à Laval.
Des grâces de toutes sortes sont
obtenues. Après une enquête et un procès canonique, l’évêque de
Laval, Mgr Wicart, déclare : « Nous jugeons que l’Immaculée Vierge
Marie, Mère de Dieu, a véritablement apparu le 17 janvier 1871, à
Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie
Lebossé dans le hameau de Pontmain. »
Pour en savoir davantage :
http://www.sanctuaire-pontmain.com |
