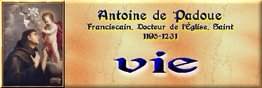

CHAPITRE VI
DANS LE LIMOUSIN (1226-1227 ?)
En
1226, les Cordeliers étaient déjà depuis trois ans établis à Limoges,
sous le nom de Menudets. Leur résidence était voisine de l'église
Saint-Paul, non loin de l'emplacement actuel de la gare. Ils n'avaient
pas été sans parler du grand apôtre qui venait de remuer le Languedoc et
le Berry. Aussi, à son arrivée, la ville de Limoges lui fit-elle une de
ces réceptions triomphales qu'expliqué la foi de l'époque. On voulait le
voir, l'entendre, toucher le bord de ses vêtements. A peine avait-il
posé le pied dans la ville, raconte la chronique de l'abbaye de
Saint-Martin de Limoges, qu'il prêchait au cimetière Saint-Paul, à
l'occasion de la commémoration des morts ou de quelque autre cérémonie
funèbre. Son discours dut faire impression ; car la chronique du
monastère bénédictin ne jugea pas indigne d'elle de nous signaler le
texte qu'il avait développé dans la circonstance. C'était le verset
suivant des psaumes du roi-prophète : " Au soir la tristesse ; au matin
la joie. " L'orateur sut tirer de cette antithèse des applications
ingénieuses, des tableaux pleins d'animation, dont il a emporté le
secret dans la tombe. Nous retrouvons le même texte dans ses notes ;
peut-être faut-il y voir la synopse de son allocution. " Il y a, dit-il,
trois soirs et trois matins, trois deuils et trois allégresses : trois
soirs, la chute de nos premiers parents, la mort du Christ et notre
propre mort ; trois matins, la naissance du Messie, sa résurrection et
la nôtre. "
Le lendemain, c'était l'abbaye elle-même qui réclamait sa présence. Il y
prononça, sur l'excellence de l'institution monastique, une allocution
qui débutait par ce cri du Psalmiste : " Qui me donnera des ailes comme
à la colombe, et je volerai à mon asile et m'y reposerai en paix. " Les
Bénédictins du mont Soubase avaient accueilli avec respect le Patriarche
séraphique et lui avaient fourni son premier lieu de prière. Leurs
frères de Limoges entourèrent de la même vénération son disciple
privilégié et lui prêtèrent également leur appui. Son passage dans leur
monastère est mentionné comme un événement dans leurs archives, et c'est
à eux que nous devons la connaissance de leurs premières relations. "
L'an 1226 — lisons-nous dans la chronique manuscrite de Pierre Coral,
abbé de Saint-Martin, de Limoges vers la moitié du xiiie siècle — le
bienheureux Antoine, de l'Ordre des Frères-Mineurs, reçut pour ses
Frères, et à certaines conditions, un local situé dans les dépendances
de notre abbaye. "
Les chroniques bénédictines se bornent à ces renseignements, auxquels
nous n'avons à reprocher que leur concision. Heureusement, l'évêque de
Tréguier, Jean Rigaud, est là pour répondre à notre attente, et nous
redire avec abondance de détails par quels moyens, prière et
prédication, vertus et prodiges, prodiges surtout, l'apôtre franciscain
prit possession de la terre du Limousin.
Le plus fameux miracle de saint Antoine est un acte de bilocation, qui
eut lieu dans la nuit du Jeudi Saint. Le Bienheureux prêchait dans
l'église Saint-Pierre-du-Queyroix et répandait sur le peuple les
semences de la parole de vie. II se souvint, au cours de son allocution,
qu'il devait réciter au couvent, à la même heure, une leçon de l'office
des matines, et qu'il avait omis de se faire remplacer. Affligé de cet
oubli, il s'arrête, demeure immobile, silencieux, et apparaît tout à
coup au milieu de ses Frères, surpris et stupéfaits. Il lit la leçon
indiquée, puis reprend ses sens dans la chaire de
Saint-Pierre-du-Queyroix et continue le sermon qu'il avait commencé.
La sagesse divine ne fait rien sans motif. Quel est donc, dans ce
prodige de bilocation, le dessein du Rédempteur ? Voulait-il, par là,
récompenser le moine de sa fidélité aux moindres observances de cette
discipline régulière qui est, pour le religieux, le chemin de la
perfection, ou se proposait-il de signaler à l'admiration du peuple
celui qui était son ambassadeur attitré, et de donner plus d'autorité à
sa parole ? Peut-être l'un et l'autre. Dans tous les cas, le second
résultat fut atteint; car les prédications du Bienheureux excitèrent un
tel enthousiasme, que bientôt il lui fallut prêcher en plein air, aucune
église n'étant assez vaste pour contenir les foules accourues pour
l'entendre. Jean Rigaud nous raconte, à ce propos, le trait qu'on va
lire.
Saint Antoine haranguait la multitude sur la place du Creux des Arènes.
Mais voici que tout à coup les nuages. s'amoncellent ; le tonnerre
gronde, les éclairs sillonnent la nue, l'orage éclate sur la ville. Les,
auditeurs, effrayés, commencent à s'enfuir; mais le thaumaturge les
retient, les rassure d'un ton plein de bonté, et faisant un admirable
acte de foi dans la puissance de Celui qui enchaîne les eaux dans
l'embrun des nues, il leur crie : " Ne craignez rien ; continuez
d'écouter la parole de Dieu, et j'espère de Celui en qui l'on n'espère
jamais en vain qu'il ne permettra pas que la pluie vous atteigne. " Ils
défèrent à son avis ; et la prédication terminée, ils remarquent que,
selon la promesse du Bienheureux, il n'est pas tombé une goutte d'eau
sur la place du Creux des Arènes, pendant que l'averse avait inondé le
reste de la, cité.
" Quand je suis entré dans l'Ordre de Saint-François, ajoute le
narrateur, plusieurs des Frères qui avaient assisté au sermon, étaient
encore vivants et se rappelaient même parfaitement le fond du thème
développé par l'orateur. Ils méritent pleinement créance, étant de ces
témoins compétents qui rapportent ce qu'ils ont vu et entendu. "
Cependant, au milieu des préoccupations d'une vie si mouvementée et
entremêlée de tant de surnaturel, " le custode " ne négligeait pas la
direction des religieux confiés à sa sollicitude. Il affermissait les
bons ; il réchauffait l'ardeur des tièdes ; il avait pitié de ceux qui
chancelaient. L'un de ces derniers, un novice nommé Pierre, qu'il avait
lui-même admis dans l'Ordre, songeait, sous l'obsession d'une pensée de
découragement, à rentrer dans le siècle. Perdre sa vocation est toujours
un malheur, quelquefois un désastre irrémédiable. Le Bienheureux fut
averti par révélation de la tentation et des angoisses intérieures du
novice. Il alla le trouver, le réconforta et lui dit, en lui soufflant
dans la bouche : " Reçois l'Esprit-Saint. " Au même moment, le novice se
sentit l'esprit entièrement rasséréné. La flèche de la tentation était
comme émoussée, et lui-même déclara plus tard qu'il n'en avait jamais
plus ressenti les atteintes.
A Limoges, le nom de saint Antoine est acclamé ; il en sera bientôt de
même dans toute la région.
Toutes les villes du Limousin se disputaient l'honneur de posséder le
puissant thaumaturge. Il accédait à leur requête, quand il le pouvait,
dépensant ses forces sans compter et semant les miracles sur ses pas.
Ce sont même ces miracles recueillis sans ordre chronologique, mais avec
un religieux respect, qui nous aideront à jalonner les principales
stations de son apostolat.
A Saint-Junien, il annonça à l'avance que la chaire improvisée d'où il
parlait serait renversée, mais que, malgré les efforts de Satan et de
ses suppôts, il n'en résulterait rien de fâcheux. La prédiction
s'accomplit. L'estrade s'écroula avec fracas au commencement de son
discours; mais personne ne fut blessé.
Dans un monastère bénédictin du même diocèse, il récompensa par une
faveur spirituelle la généreuse hospitalité que lui fournissaient les
fils de saint Benoît,
Il était souffrant. Le religieux qui le soignait apprit bientôt qu'il
fait bon vivre, ne fût-ce qu'une heure, dans la compagnie des saints. Ce
pauvre moine, souffleté, comme saint Paul, par le démon du vice impur,
était en proie à de violentes tentations. Eclairé d'en haut sur l'état
de trouble de cette âme, le thaumaturge ne put refouler le sentiment de
commisération qui l'étreignait. Il lui dépeignit, comme s'il y eût
assisté, toutes les péripéties de cette agonie intérieure, puis le
détermina, à force d'aimables instances, à revêtir la tunicelle que
lui-même venait de quitter. L'ombre de saint Pierre guérissait les
malades. La robe de saint Antoine ne fut pas moins efficace. De cette
tunique sanctifiée au contact d'une chair virginale, se dégagea une
vertu qui apaisa l'orage des sens et délivra pour toujours le moine
agenouillé à ses pieds.
Ailleurs ,(Le biographe ne cite pas plus qu'au paragraphe précédent le
nom de la localité), c'étaient ses propres Frères qu'il prémunissait
contre les illusions diaboliques et les tentations propres à l'état
religieux. Un soir, après complies, il vaquait selon son habitude à
l'exercice de l'oraison, et ses Frères avec lui. Ceux-ci, en sortant de
l'oratoire, aperçurent aux demi-clartés de la lune, une foule de
malfaiteurs occupés à dévaster la moisson du champ voisin, qui
appartenait à l'un des bienfaiteurs du couvent. Ils coururent en avertir
leur vénérable custode, resté en prière dans l'oratoire et tout abîmé
dans le sentiment de la présence de Dieu. " Ne vous tourmentez pas, leur
répondit-il, et retournez à votre méditation. Ce n'est là qu'une ruse de
l'ange des ténèbres, qui cherche tantôt à troubler votre repos nocturne,
tantôt à vous détourner de l'oraison. Demain il n'y aura rien de détruit
dans le champ de notre bienfaiteur, " Le lendemain, au point du jour,
les religieux constatèrent que la moisson était intacte ; et leur
vénération, déjà grande pour un supérieur si richement orné des dons de
l'Esprit-Saint, s'en accrut encore.
Les épisodes qu'on vient de lire nous parviennent avec une signature qui
enlève au critique toute pensée de suspicion. Le nom de Jean Rigaud nous
en garantit l'exactitude. Il n'en est pas de même d'une foule d'autres
traits insérés dans des recueils hagiographiques de basse époque,
principalement dans le "Liber miraculorum": traits de provenance
inconnue et de véridicité problématique, mais que nous nous
reprocherions pourtant de passer entièrement sous silence. Ils serviront
au moins à démontrer quelle haute idée on se faisait du thaumaturge
franciscain vers la fin du moyen âge.
Ici, c'est un enfant tombé dans une chaudière d'eau bouillante et
préservé de toute brûlure par l'intercession du serviteur de Dieu ; là,
un enfant qu'il ressuscite et qu'il rend à sa mère ; ailleurs, il
restitue miraculeusement à une femme du Limousin " la chevelure que lui
a brutalement arrachée son mari ". Plus loin, il ordonne à un pauvre
pécheur suffoqué par l'émotion et le repentir, d'écrire ses fautes sur
une feuille de parchemin ; et à mesure que le pénitent les accuse, un
ange du ciel les efface.
Enfin voici le trait le plus merveilleux, le plus populaire aussi :
l'apparition de l'enfant Jésus, Au cours de ses prédications,
l'intrépide missionnaire était descendu chez un bourgeois qui lui
offrait l'hospitalité. Là, se livrant à son attrait pour l'oraison, il
prolongea sa veille bien avant dans la nuit. Par une disposition
spéciale de la Providence, le bourgeois l'aperçut, au sein d'une lueur
surnaturelle, plongé dans les délices de l'extase et portant dans ses
bras l'enfant Jésus.
Telle est, en abrégé, la célèbre apparition de l'enfant Jésus, qui
formerait la page la plus idéale, la plus suave de l'hagiographie, si
l'on pouvait en prouver la réalité. Malheureusement, le doute plane sur
le fond comme sur les détails de cette vision. Elle ne repose que sur
l'assertion d'une compilation de la fin du xive siècle, le "Liber
miraculorum", dont tous les matériaux sont loin d'avoir la même valeur ;
et la critique ne peut l'admettre que sous réserves. Vraie ou non, les
arts l'ont mise en relief et popularisée. Pas immédiatement toutefois ;
car la plus ancienne représentation de l'enfant Jésus sur les bras de
saint Antoine ne remonte qu'à l'année 1495. C'est un rétable qui se
trouve à Pollenza, près de Macerata, province des Marches. Mais à partir
du xviie siècle, elle est devenue une attribution iconographique du
thaumaturge, et bientôt l'attribut prédominant le plus goûté, sans doute
parce qu'il offre un groupe plus harmonieux et un symbolisme plus
expressif.
Le merveilleux fleurit ainsi à toutes les pages du "Liber miraculorum";
mais au merveilleux nous préférons le vrai, toujours, surtout lorsqu'il
s'agit d'un thaumaturge tel que saint Antoine. Il n'a pas besoin d'une
auréole d'emprunt ; sa propre gloire lui suffit : elle jette un lustre
incomparable. Ecoutons ce qu'affirmé à ce sujet la véritable histoire
par la bouche de l'évêque de Tréguier : " Oh ! l'heureux prédicateur !
Il prêchait d'exemple et de parole, à tous, sans acception de personnes,
et d'éclatants prodiges venaient confirmer la vérité de sa doctrine. "
Voilà bien l'envoyé de Dieu, tel que l'image s'en est conservée dans
l'esprit des populations du Limousin, allant d'une bourgade à l'autre,
guérissant les malades et réconfortant, selon l'occurrence, les esprits
dévoyés, les cœurs déchus, les enfants souffreteux, les mères en deuil,
tous ces désespérés de la vie dont chaque siècle entend les plaintes ou
les récriminations. Voilà le thaumaturge semant la doctrine de vie et
les faveurs célestes, comme le laboureur sème le froment, à pleines
mains. Et voilà aussi le moissonneur fortuné relevant les épis d'or et
liant, dans les champs du Père de famille, des gerbes aussi précieuses
que serrées.
Cependant, à travers ses courses apostoliques " dans le diocèse de
Limoges, il était poursuivi par ce besoin de solitude qui fut le
tourment de sa vie. Apercevant sur sa route, aux environs de Brive, à
l'arrière-plan du vallon baigné par la Corrèze, une roche solitaire, il
s'y arrêta et y fonda un ermitage dans le genre de celui de Monte-Paolo.
L'hagiographe limousin nous certifie le fait en termes qui excluent le
doute. " C'est le Bienheureux en personne, écrit-il, qui implanta à
Brive l'Ordre des Mineurs. Il leur bâtit un couvent à une assez grande
distance de la ville. " A ces détails authentiques, mais un peu
sommaires, le "Liber miraculorum" en ajoute de complémentaires, avec la
précision d'un pèlerin qui a visité ces lieux. " Antoine, remarque-t-il,
se retira à l'écart, dans une grotte. Il s'y tailla une cellule, creusa
dans la pierre une fontaine destinée à recevoir les gouttes d'eau qui
suintent du rocher, et alors s'abandonna sans crainte aux délices de la
contemplation, non moins qu'aux rigueurs de la pénitence. " Le
merveilleux l'accompagna jusque dans ce désert. La pauvreté y était
extrême ; on manquait de tout, excepté de courage et d'amour de Dieu.
Dans un moment de détresse, le vénéré custode pria une dame de Brive,
une de ses bienfaitrices, de subvenir aux besoins de sa petite
communauté et de lui envoyer des légumes. Elle le fit avec empressement,
malgré une pluie torrentielle et persistante qui aurait pu paralyser les
volontés les plus énergiques, et chargea sa servante d'aller au jardin
et de porter à l'ermitage les trésors de la charité. Après quelques
objections, la domestique céda aux instances de sa maîtresse et partit,
affrontant la rafale. Or, à son retour, elle raconta avec admiration
comment elle avait tout le temps marché sous la pluie, sans qu'une seule
goutte d'eau eût mouillé ses vêtements. Pierre de Brive, fils de la
bienfaitrice et chanoine de la collégiale de Saint-Léonard de Noblac, se
plaisait à narrer cet épisode dans tous ses détails. Il avait raison ;
car le fait, si vulgaire qu'il paraisse, renferme un profond
enseignement. Il nous rappelle que rien n'est petit de ce qui se fait
avec esprit de foi et que le Seigneur ne laisse sans récompense ni les
sublimes dévouements ni le verre d'eau froide donné en son nom.
Disons-le tout de suite, le séjour de saint Antoine aux grottes de Brive
ressemble à ses autres étapes à travers la France : ce n'est qu'une
halte, la halte rapide du soldat qui se repose sur les lauriers de la
veille et songe aux combats du lendemain. Mais quand le soldat est un
Envoyé de Dieu, la roche où il a posé le pied n'est plus seulement un
souvenir historique ; elle devient une source de grâces et de
bénédictions, et les générations qui en bénéficient se redisent les unes
aux autres : Heureuses vallées de l'Hérault et de la Garonne, que le
thaumaturge portugais a comblées de ses bienfaits et fécondées de ses
sueurs ! Heureuses montagnes du Velay et du Limousin, qui ont été le
Thabor de sa contemplation et de ses extases !
Les chroniques médiévales racontent avec complaisance les merveilles
accomplies dans les régions du Centre. Mais ce qu'elles ne nous disent
pas, ou ce qu'elles disent en termes trop vagues, ce sont les fruits de
ces courses apostoliques : la France attentive, les consciences
réveillées, le fléau de l'hérésie albigeoise écarté, la foi vengée, la
pureté des mœurs remise en honneur, les discordes apaisées, la paix
rétablie au sein des familles. C'est, en un mot, la restauration sociale
opérée d'une manière admirable, sans secousse, sans effusion de sang,
par la seule force de la persuasion. Le résultat tient du prodige, on ne
saurait le nier, pour peu qu'on se souvienne que cette glorieuse
campagne, au pays des Lémovices, s'est effectuée dans l'espace de sept à
huit mois, peut-être moins ! Car déjà l'apôtre touche à la fin de sa
mission en France, et la Providence lui réserve un autre théâtre avec
d'autres lauriers.
Vers la fin de l'année 1226, le Fr. Elie, chargé provisoirement du
gouvernement de l'Ordre, adressait à tous les provinciaux et custodes,
conformément à la Règle, une circulaire annonçant le glorieux trépas du
vénérable fondateur et portant indiction du Chapitre général pour le 30
mai de l'année suivante. La lettre appréciait en termes émus la mission
providentielle du Patriarche d'Assise et s'ouvrait par ce cri de douleur
: " Avant de commencer à parler, je pleure, et ce n'est pas sans motif.
La douleur envahit mon âme comme un torrent qui déborde. Hélas ! Le
malheur que je redoutais a fondu sur nous : celui qui nous consolait
n'est plus ! Chéri de Dieu et des hommes, il est monté au séjour de la
lumière, lui qui enseignait à Jacob la loi de la science et de la vie,
et qui a laissé à Israël le testament de la paix. Nous ne saurions trop
nous réjouir pour lui ; nous ne saurions trop pleurer sur nous-mêmes,
privés que nous sommes de sa présence et comme ensevelis dans l'ombre de
la mort.... Invoquez-le, afin de mériter de participer à sa gloire, et
priez-le de mettre à notre tête un autre lui-même, un chef vaillant
comme les Machabées, pour nous conduire au combat. "
Nul n'avait plus amèrement pleuré que saint Antoine la perte du Séraphin
d'Assise. Nul ne pria avec plus de ferveur pour que, du haut du ciel, il
veillât encore sur ses enfants et plaçât à leur tête un autre lui-même,
un homme capable de maintenir et d'organiser, en lui gardant son cachet
primitif, une institution si nécessaire au bien de l'Eglise. Il fut
chargé par ses frères d'une mission spéciale et secrète auprès du
Souverain Pontife, mission relative probablement à la candidature du Fr.
Elie, dont on redoutait les innovations et le relâchement et qu'on
voulait écarter. Parti de Limoges dans le courant de février 1227 (date
approximative, assignée par Azzoguidi), il descendit les bords du Rhône
et s'achemina vers Marseille : voyage qu'il effectua rapidement et qui
fut signalé, au témoignage de Jean Rigaud, par un merveilleux acte de
reconnaissance.
Au moment où son compagnon et lui entraient, harassés de fatigue et
encore à jeun, dans une petite bourgade de Provence, une femme du
peuple, touchée de compassion, les invita à venir prendre un peu de
repos dans sa maison. D'un grand cœur et d'une foi plus grande encore,
elle les reçut comme Marthe recevait Nôtre-Seigneur à Béthanie, avec une
charité parfaite, posa le pain et le vin sur la table et courut
emprunter un verre à sa voisine. Mais, soit inadvertance, soit
maladresse, le compagnon du Saint, en déposant le verre sur la table, le
brisa en deux. Autre accident plus fâcheux encore, l'hôtesse, en
retournant au cellier, s'aperçut qu'elle avait oublié de fermer le
robinet du tonneau et que le vin s'était répandu sur le sable. Quelle
perte pour elle ! Elle ne put contenir son chagrin et en fit part à ses
deux hôtes. Ce ne fut pas en vain. Le Bienheureux, se cachant le visage
des deux mains pour prier plus à son aise, conjura l'Auteur de tout bien
d'avoir pitié de l'affliction d'une chrétienne si généreuse et de ne pas
laisser sa bonne œuvre sans récompense. Sa prière monta, comme une
flèche, droit au cœur de Dieu : car soudain la coupe et le pied du verre
se rapprochèrent et le verre se redressa. A ce spectacle, la paysanne
demeura stupéfaite ; puis ayant la conviction du miracle et persuadée
que celui qui avait fait un premier prodige, pourrait bien en opérer un
second et lui rendre le vin perdu, elle courut au cellier. Là, nouvelle
surprise ! Son tonneau était plein, et le vin bouillonnait et débordait
comme au sortir du pressoir. Ivre de joie et hors d'elle-même, elle ne
savait comment exprimer la vivacité de sa gratitude. Mais déjà le
thaumaturge, toujours humble, détaché de tout et de lui-même, s'était
dérobé à des louanges et à des marques de vénération qui ne doivent se
rapporter qu'à Dieu.
Cet épisode nous prouve d'une manière certaine que notre Bienheureux
traversa la Provence. Mais le reste du voyage nous échappe. Marseille
fut-elle sa dernière étape, ainsi que le prétend Azévédo ? Y prit-il un
peu de repos et visita-t-il ce rocher granitique — autrefois souillé par
les idoles et les sacrifices sanglants du druidisme — où le prêtre
Pierre venait d'inaugurer un pèlerinage réparateur et sanctifiant,
devenu célèbre depuis sous le nom de Notre-Dame de la Garde ? Toutes ces
suppositions sont plausibles ; mais nous demandons les documents, et il
n'y en a pas ! Mieux vaut saisir l'apôtre franciscain au moment où la
frêle embarcation qui l'emporte vers l'Italie est déjà loin du rivage.
Il revit par la pensée les douces émotions du passé, enveloppe d'un
dernier regard les côtes de la Provence, baignées dans l'azur du ciel,
et dit adieu à ces montagnes illustrées par les larmes de
Marie-Madeleine, à cette terre du Languedoc où il a replanté la croix, à
ces rudes montagnards du Velay et du Limousin qui l'ont entouré de leurs
délirants enthousiasmes, à cette France à laquelle il a consacré le
meilleur de son âme. De loin, il bénit encore cette fille aînée de l'Eglise,
dont il pressent le réveil et les glorieuses destinées, et qu'il emporte
dans son cœur de prêtre et d'apôtre.
Les prières d'un saint sont une force; sa bénédiction, un germe de
résurrection et de vitalité. Deux ans après le départ d'Antoine, le
conflit qui a ensanglanté le Midi de la France et failli rompre l'unité
religieuse et nationale se dénouera pacifiquement, grâce à la sagesse de
la régente Blanche de Castille, par le traité de Poitiers. On y
stipulera le mariage de Jeanne de Toulouse avec Alphonse de Poitiers,
frère de Louis IX. L'hérésie albigeoise, œuvre de perfidie et de
violence, se dissipera comme se dissipent les ténèbres aux premières
lueurs du matin; la vérité reconquerra son empire, et, avec Saint Louis,
la France atteindra le faîte de sa gloire. Elle sera l'arbitre des
nations de l'Europe, la terreur des Sarrasins, l'épée de l'Église. Saint
Thomas et saint Bonaventure mettront dans ses mains le sceptre de la
science, pendant que des génies inconnus couvriront son sol d'une
luxuriante végétation de monuments gothiques tels que Notre-Dame de
Chartres, de Rouen , de Reims, de Beauvais. Le thaumaturge franciscain
verra poindre l'aurore de ces beaux jours. Plus que personne, hormis
saint Dominique, il aura préparé les triomphes de la Croix; plus que
personne, il aura, travaillé au relèvement et à la grandeur morale de
notre pays.
La France, de son côté, ne sera pas ingrate à son égard. Elle lui
donnera une place de choix, à côté du fils des Gusman, dans le culte
d'honneur et d'admiration qu'elle rend à ses meilleurs libérateurs, à
ces hommes d'élite que la Providence lui envoie, aux jours mauvais, pour
la sauver de l'erreur et de l'anarchie. Il en sera le Saint populaire
par excellence, comme il en a été l'apôtre populaire. Les petits, les
humbles, les habitants des hameaux, les convertis des grandes villes,
tous ceux qu'il aura guéris ou consolés, célébreront ses bienfaits,
rediront ses miracles, lui érigeront des autels; et le temps qui efface
tout, ne fera que rajeunir sa mémoire et grandir ses vertus. Son culte
fleurira dans toutes nos provinces, embaumant les rivages de la
Méditerranée, non moins que les montagnes du Velay et les vallées de la
Corrèze. Faut-il s'en étonner ? Sans doute, un Saint n'est étranger
nulle part, parce que l'Église est la patrie des âmes ; mais quand il a
versé ses sueurs sur le coin de terre que nous habitons, quand il y a
multiplié les miracles, il a droit à un culte plus intime, plus vivace,
plus débordant; il est deux fois notre frère.


 



|
