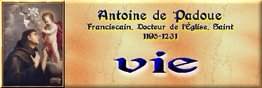

CHAPITRE
II
LE
CHANOINE DE SAINT-AUGUSTIN (1210 - 1220 ?)
C'était en 1210, " don Fernando avait quinze ans révolus : " l'âge des
rêves et des espérances ! Briser tous ces rêves, renoncer à toutes ces
espérances, quitter le toit paternel, une mère adorée, des amitiés,
précieuses, pour une nature aussi aimante que la sienne, le sacrifice
était dur ! Il le fit sans hésitation ni réserve, avec la spontanéité et
l'énergie d'une âme qui préfère l'héritage des saints à toutes les
couronnes de la terre, et put redire en toute vérité, avec le
Roi-Prophète : " Le passereau et la tourterelle se bâtissent un nid pour
déposer leurs petits. Pour moi, Seigneur, vos autels seront à jamais ma
demeure, "
Le Prieur du monastère, don Gonzalve Mandez, l'accueillit avec
bienveillance. Nous avons ici un indice que les parents ne refusèrent
pas leur consentement à la vocation de leur fils ; car, peu de temps
après, il revêtait, sans obstacle et dans la plénitude de sa liberté, la
robe blanche et l'aumusse des Chanoines réguliers de Saint-Augustin. "
Il le fit avec humilité et dévotion ", ajoute son biographe. Deux mots
bien riches dans leur concision; car ils nous révèlent les sentiments
intimes et les beautés d'un cœur tout pétri d'esprit de sacrifice et
d'amour de Dieu.
" Qui a donné son cœur a tout donné ", écrira-t-il plus tard. Il a donné
son cœur à Dieu ; il ne le reprendra pas, mais il ne laissera pas d'être
en butte à de terribles assauts dont les documents primitifs vont nous
révéler la nature.
Le monastère était tout près de Lisbonne, trop près. Cette proximité
permettait, entre le jeune chanoine et " ses amis ", une fréquence de
rapports qui n'était pas sans troubler la paix de sa cellule. Ces
visiteurs — que les vieilles chroniques qualifient " d'amis charnels ",
c'est-à-dire imbus de cet esprit du monde qui est en éternelle
contradiction avec l'esprit de l'Évangile, n'épargnaient rien de ce que
peut suggérer l'affection pour le ressaisir et l'arracher au cloître. Il
résistait victorieusement à toutes les attaques, à toutes les séductions
; mais sachant par expérience que la lutte contre ceux qu'on aime finit
par énerver les caractères les mieux trempés, et ne voulant à aucun prix
s'exposer à perdre le trésor de sa vacation, il résolut de se dérober à
leurs sollicitations importunes et de chercher une autre tente pour s'y
fixer. Il rencontra un obstacle inattendu dans le refus de Gonzalve
Mendez, " qu'avaient charmé les rares qualités du fils de don Martin,
ses talents, sa piété angélique, son exquise amabilité ", et qui fondait
sur lui les plus grandes espérances. " Ayant enfin obtenu, à force de
larmes et de prières, l'autorisation du Père Prieur, il quitta, non la
milice où il s'était enrôlé, mais le théâtre du combat, non par caprice,
mais dans un élan de ferveur, et se transporta au monastère de
Sainte-Croix de Coïmbre . "
L'abbaye de Sainte-Croix avait sur celle de Saint-Vincent de Lisbonne
l'avantage inappréciable d'être le berceau de l'institut augustinien.
Là, on respirait encore le parfum des vertus de saint Théotonio, son
premier Prieur ; là, étaient la source des traditions et les ossements
des premiers fondateurs. La discipline régulière, qui est l'âme de la
vie cénobitique, y florissait, et don Fernando y trouva ce qu'il
cherchait : des frères, la paix et Dieu.
Qu'étaient exactement les Chanoines réguliers de Sainte-Croix, et quelle
formation religieuse don Fernando reçut-il chez eux ? Cette question a
été traitée avec une rare érudition par M. l'abbé Lepître.
" Le terme général de " Chanoine ", remarque-t-il, semble avoir désigné,
dans l'Église d'Occident, des clercs voués au service d'une église en
suivant une règle. Ils n'avaient pas tout d'abord les mêmes
constitutions ; mais au IIe concile de Latran, Innocent II ordonna que
tous suivissent la règle de saint Augustin (1139). Cette règle était
ainsi dénommée, non qu'elle vînt du grand docteur d'Hippone, mais parce
qu'elle était basée sur ses deux discours "De moribus clericorum suorum",
et sur sa Lettre CCXI, adressée à des Religieuses.
" Les prescriptions dont elle se composait étaient assez larges pour
permettre d'accorder beaucoup au ministère des âmes. Mais il était
loisible aux différentes communautés augustiniennes de compléter ces
prescriptions, ou bien encore de les spécifier et de les préciser. C'est
ce qu'ont fait les congrégations de Prémontré, de Saint-Victor de Paris
et de Sainte-Croix de Coïmbre, pour ne parler que de celles-là. Ce
monastère avait été fondé en 1132 par D. Tello, archidiacre du diocèse,
et avait eu pour premier prieur saint Théotonio. Les rois de Portugal et
les souverains pontifes s'étaient plu à favoriser la nouvelle
congrégation. Sainte-Croix comptait, dès les premières années de son
existence, soixante-douze religieux; elle était exempte de la
juridiction de l'évêque, et elle avait sous sa dépendance plusieurs
paroisses, en particulier celle de Lercina. N'oublions pas que l'office
des Chanoines réguliers, à quelque congrégation qu'ils appartinssent,
n'était pas seulement le service du chœur, mais encore le soin du salut
des âmes, dans l'église où ils se trouvaient ou dans les paroisses
soumises à sa juridiction. "Clericus regularis mysteria Dei dispensat",
est-il dit formellement dans leurs constitutions. N'allons pas les
considérer comme des moines ; ils étaient regardés comme étrangers à
l'état monastique... Ajoutons ici un trait caractéristique de tous les
chanoines réguliers ; ils étaient voués d'une manière particulière à
l'étude. Mais cette étude avait un but spécial : rendre les sujets plus
propres au service de Dieu et des âmes et les préparer, s'ils avaient
des aptitudes suffisantes, à remplir les fonctions pastorales dans
l'Église. Le monastère donnait une instruction élémentaire aux enfants
qui fréquentaient son école. Il la départissait plus abondante et plus
complète aux jeunes gens qu'il voulait garder, et il accordait des soins
tout particuliers aux chanoines qui se trouvaient mieux doués que leurs
frères en religion.
" Sainte-Croix de Coïmbre était fidèle à l'esprit comme à la lettre de
ces constitutions. Comme le monastère de Saint-Ruf d'Avignon jouissait
d'un renom bien établi de ferveur, elle avait envoyé l'un de ses
membres, le prêtre Pierre, pour en étudier les usages et les faire
connaître à ses frères. Celui-ci, par deux fois, fit un assez long
séjour à Saint-Ruf, en examinant ce qui pouvait manquer à son couvent
sous le rapport de la régularité ou de la doctrine. Il est dit que la
seconde fois il avait rapporté un Capitulaire, la manière de chanter les
antiennes, le Commentaire de saint Augustin sur saint Jean ainsi que sur
certaines questions des Évangiles selon saint Mathieu et saint Luc, l'Hexameron
de saint Ambroise, avec son Pastoral et son livre sur la Pénitence,
enfin le Commentaire de Bède sur saint Luc.
" Pour mieux faire connaître encore le milieu où Fernando vécut, tant
qu'il demeura chez les chanoines réguliers, rappelons en deux mots ce
qu'avait été saint Théotonio", le premier prieur de Sainte-Croix. Il
avait dû laisser dans son monastère une trace non encore effacée,
puisqu'il l'avait gouverné pendant vingt ans avec une sagesse qui
faisait l'admiration de tous. Le roi Alphonse Ier ne partait jamais pour
une expédition sans se recommander à ses prières. Les séculiers se
présentaient souvent à sa porte pour être admis à le voir. Mais cette
faveur leur était rarement accordée, le saint Prieur redoutant
l'intrusion du monde dans sa communauté. Saint Théotonio entretenait des
relations d'amitié avec saint Bernard, et sur la fin de sa vie, il
aimait à s'appuyer sur un bâton qu'il avait reçu de l'abbé de Clairvaux.
"
La Providence conduisait don Fernando vers des rivages où se dessinerait
bientôt sa vocation définitive. Mais lui, ignorant les mystères de
l'avenir, ne songeait qu'à profiter des douceurs de la solitude qui lui
était ménagée, pour fermer son cœur à tous les enchantements de la terre
et l'ouvrir à toutes les inspirations du ciel. Il avait en mémoire, nous
dit son premier biographe, l'adage de saint Jérôme : " L'important n'est
pas d'habiter un lieu saint, mais d'y vivre saintement " ; et il
n'entendait pas être un religieux à demi. Il se donnait tout à Dieu ; il
se donnait tout au devoir. Le chœur, la cellule, le jardin, ces trois
théâtres qui se partagent la vie claustrale, étaient témoins de ses
progrès incessants. Le son de la cloche était pour lui la voix de Dieu ;
la psalmodie faisait ses délices, la mortification son armure,
l'obéissance la joie de son cœur, l'oraison et les entretiens prolongés
avec le Maître suprême sa meilleure consolation.
Ecole de ferveur et de perfection, l'abbaye était en même temps, grâce
aux libéralités du roi de Portugal, un centre de culture littéraire, un
véritable foyer de lumière rayonnant sur tout le royaume et acheminant
peu à peu les esprits vers la création de la célèbre Université de
Coïmbre. Don Fernando put donc se livrera loisir, et plus facilement
qu'à Lisbonne, à son attrait pour la science sacrée. Il est difficile
d'admettre qu'il n'ait pas au moins parcouru les classiques latins alors
en vogue dans les écoles, Boèce, Virgile, Ovide ; mais dans tous les
cas, la théologie, les Pères de l'Eglise, les gloses scripturaires,
l'histoire, la controverse, eurent ses préférences ; et le Livre par
excellence, la Bible, plus encore que tout le reste. Sa foi se
fortifiait dans la méditation des pages inspirées, et sa piété
s'alimentait à ces sources d'eau vive, pendant que son intelligence
s'armait de preuves invincibles comme d'autant de flèches enflammées
qu'il s'apprêtait à lancer, en temps opportun, contre l'ennemi. Et
l'ennemi, il le connaissait. Ce n'était plus le mahométisme avec ses
doctrines abrutissantes; c'était l'hérésie manichéenne, pieuvre hideuse
qui étendait ses tentacules sur tous les Etats de l'Europe.
Quand le térébinthe trouve un terrain propice, il y plonge ses racines
et étend au loin sa verte et puissante ramure. Le cloître de
Sainte-Croix était pour le fils de don Martin ce terrain propice. Son
beau talent s'y développait à l'aise. Nous disons son beau talent; car
la nature l'avait richement doté. Sa mémoire était prodigieuse. Tous les
trésors de la science s'y entassaient sans effort, sans confusion. " Il
retenait tout ce qu'il lisait ", remarque son historien. En face d'une
si vaste érudition unie à une si grande jeunesse, ses maîtres ne
cachaient pas leur admiration. Elle se traduisait par une appréciation
qu'ils insérèrent plus tard dans les archives du monastère et que nous
enchâssons comme une perle précieuse dans notre récit. " Don Fernando,
écrivent-ils, était un homme fameux, un esprit cultivé, un religieux
d'une sainteté éminente. "
Tant d'avantages déterminèrent ses supérieurs à le présenter aux Ordres
sacrés. Quel jour, en quelle année fut-il promu au sacerdoce ? Quelles
furent les impressions de cette inoubliable journée ? Ses genoux
tremblèrent-ils, sa voix fut-elle étouffée par l'émotion, lorsqu'il
monta pour la première fois à l'autel ? Tout ici échappe à nos
investigations. La "Chronique des vingt-quatre Généraux" et le bréviaire
des Chanoines réguliers du Portugal affirment qu'il était prêtre en 1219
; le Bréviaire romain le nie. La cause est toujours pendante et ne
paraît pas près d'être jugée. Question bien secondaire après tout et
dont nous ne voulons retenir qu'un point : c'est qu'en l'année ,1219, la
formation intellectuelle de don Fernando est terminée. A son tour de
paraître en public ; à son tour d'instruire les hommes de sa génération.
Seulement, ce ne sera mi à Coïmbre ni dans aucune ville du Portugal, ni
sous la robe des disciples de saint Théotonio, qu'il déversera les
trésors de doctrine amassés à l'ombre des cloîtres augustiniens.


 



|
