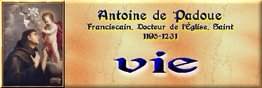

CHAPITRE PREMIER
RADIEUSE ENFANCE
Saint François d'Assise, ce grand
initiateur monastique du moyen âge, a laissé une postérité plus nombreuse que
les étoiles du firmament, une famille spirituelle qui s'attache à reproduire ses
vertus et continue, à travers les âges, une mission toujours identique,
populaire, pacifique et civilisatrice au premier chef. Il nous apparaît, dans
l'histoire, entouré d'une pléiade de grands hommes et de saints qui lui font
cortège sans l'éclipser. Mais, de tous ses fils, celui qui a le plus hérité de
son zèle apostolique comme de sa douceur, est l'aimable Saint dont Montalembert
a dit : "A peine le Séraphin d'Assise a-t-il été prendre son rang devant le
trône de Dieu, que sa place dans la vénération et l'enthousiasme des peuples est
occupée par celui que tous proclamaient son premier né, saint Antoine de Padoue,
célèbre comme son père spirituel par cet empire sur la nature qui lui valut le
surnom de thaumaturge ."
Saint Antoine de Padoue, le
contemporain et l'émule du patriarche des pauvres, la perle de l'Ordre
séraphique, telle est la belle et ravissante figure que nous voulons dessiner
dans ces pages.
Padoue eut l'honneur de l'enfanter
à la vie de l'éternité, mais non à la vie du temps. C'est loin de là, sous un
ciel non moins fortuné, en face de l'Océan, dans un royaume de formation alors
toute récente, le Portugal, qu'il vint au monde, sur le déclin du XIIe
siècle.
Les climats et les milieux ont
leurs influences. Aussi nous semble-t-il nécessaire, pour expliquer la trempe de
caractère de notre Bienheureux et faire connaître le point de départ d'une
existence toute merveilleuse d'un bout à l'autre de dire un mot de la situation
politique du pays où s'écoulèrent ses premières années.
Il est peu d'histoires aussi
tourmentées que celle du, Portugal. Tour à tour ravagé par les Vandales, les,
Suèves, les Alains, les Visigoths, il était tombé au VIIIe
siècle au pouvoir des Arabes et avait gémi pendant quatre siècles sous leur
domination. Enfin vint un chevalier de race franque, Henri de Bourgogne, allié
aux rois de France et neveu d'Henri Ier, qui aida les souverains d'Espagne à
refouler les hordes musulmanes au delà des mers. Admirateur et émule du Cid, il
livra aux Almohades dix-sept batailles qui furent pour lui autant de victoires,
et mourut, couvert de lauriers, au siège d'Astorga (1112). Son fils, Alphonse
Ier, acheva l'œuvre de la libération, abattit l'empire mauresque dans les champs
de Castro-Verde, fut acclamé roi par ses troupes et fit hommage de ses États au
pape Innocent II, qui lui confirma le titre et les droits de souverain, malgré
les réclamations de l'Espagne (1142). Il ne laissait aux sectateurs du Prophète
que la pointe de la péninsule ibérique, la province des Algarves. Il effaça peu
à peu, par une administration aussi ferme que sage, les traces d'une invasion à
jamais abhorrée, remplaça les mosquées par des églises et, pour perpétuer le
souvenir d'une délivrance inespérée, fit bâtir plusieurs monastères, entr'autres
celui de Sainte-Croix de Coimbra (1184) et sa filiale, Saint-Vincent de Lisbonne
(1147), qu'occupèrent les chanoines réguliers de Saint-Augustin.
Coimbra était la résidence de la
cour. Une autre ville, "la reine des mers". comme, l'appellent ses habitants,
Lisbonne, cité antique, gracieusement assise sur la rive droite du Tage, port de
mer où commençaient à affluer les richesses de l'Orient et de l'Occident,
s'apprêtait à lui ravir son titre de capitale du royaume. Le peuple avait le
génie des conquêtes ; ce petit royaume était déjà florissant, et une fois
affermi dans son indépendance, il allait lancer sur toutes les mers ses flottes
ombragées par la croix.
Ainsi le Portugal est né d'un acte
de foi sur un champ de bataille ; ainsi il grandit sous l'auguste protection du
Pontife romain, dont il se déclare hautement le tributaire et le vassal. Nation
fière, jeune et pleine de vie, "dont l'éternel honneur, selon le mot de Léon
XIII, est de s'être constamment laissé guider par une politique profondément
chrétienne et d'avoir toujours eu pour mobile principal, dans ses expéditions
lointaines, l'extension du règne de l'Évangile parmi les infidèles". Toutes les
qualités de la race vont resplendir au front d'un héros, qui est la plus noble
et la plus haute personnification de l'âme de sa patrie. Ce héros, nous l'avons
nommé. C'est lui qui nous occupe d'un bout à l'autre de cet ouvrage ; il est
temps de le faire connaître.
Il naquit à Lisbonne, en 1195, de
parents, dont les chroniques contemporaines parlent avec beaucoup d'éloges, mais
sans jamais les désigner par leur nom. "Ils appartenaient à la classe des nobles
et des puissants", atteste le padovanais Rolandino. " C'étaient des personnages
vénérables" , ajoute l'auteur anonyme de la "Legenda secundo", ; "justes devant
le Seigneur et scrupuleux observateurs de ses commandements", déclare de son
côté l'hagiographe limousin Jean Rigaud.
Là s'arrêtent les documents de la
première heure, du moins ceux que nous connaissons aujourd'hui, et le lecteur
peut constater avec nous combien les premiers historiens se préoccupent peu de
répondre à nos interrogations sur les ascendants et le nom patronymique du
Saint. Les écrivains des âges postérieurs ont tenté de combler cette lacune ; et
c'est à ce sentiment qu'a obéi l'auteur d'une légende anonyme du XIVe
siècle récemment découverte, la légende Benignitas, où nous lisons : "Le père du
Bienheureux, chevalier du roi Alphonse II , se nommait Martin, et sa mère, dona
Maria, issus l'un et l'autre de familles nobles." Dans l'impossibilité où nous
sommes de contrôler ces détails mentionnés pour la première fois par l'ouvrage
en question, nous ne pouvons les accepter que "sous bénéfice d'inventaire".
On remarquera que nulle part,
jusque-là, il n'est fait la moindre allusion à Godefroy de Bouillon, ni à la
maison de Lorraine. C'est Marc de Lisbonne, en effet, évêque de Porto et
chroniqueur du XVIe
siècle, qui le premier, parmi les hagiographes, a lancé l'affirmation suivante,
sans nous dire à quelles sources il en avait puisé les éléments. "Le père du
Bienheureux s'appelait Martin de Bouillon, et sa mère, Thérèse Tavéra, tous deux
de lignées antiques, tous deux recommandables pour l'éminence de leurs vertus."
Assertion vite enregistrée et développée avec plus de complaisance que de
critique par Miguel Pacheco et par Manuel Azevedo, qui assignent pour chef, à
cette branche des Bouillon, un des chevaliers francs accourus, lors de la
seconde croisade, au secours d'Alphonse Ier et présents à la bataille de Zalaka.
A leur suite, la plupart des historiens français avaient embrassé de confiance
une opinion si flatteuse pour notre amour-propre national ; mais aujourd'hui, en
l'absence de tout fondement sérieux, la critique, une critique impartiale et
sévère, la relègue parmi les inventions postérieures à la Renaissance. Ce
serait, du reste, se méprendre étrangement sur le caractère des saints que de
chercher à les grandir, en leur dressant des généalogies purement fantaisistes.
Leur mérite intrinsèque se puise ailleurs et plus haut ; ils n'ont besoin que de
la vérité, et voilà pourquoi nous avons hâte de retourner aux documents
contemporains, les plus aptes, sinon les seuls, à nous renseigner d'une manière
certaine sur la famille du héros portugais.
La légende primitive se borne à
nous peindre d'un mot la haute situation qu'occupaient ses parents. "Ils
habitaient, nous dit-elle, un somptueux palais, proche de la cathédrale de
Lisbonne." Elle se tait absolument sur leur nom, leurs origines et leurs
illustrations ancestrales. C'est qu'aux yeux de l'auteur anonyme qui l'a
composée, homme de grand sens, après tout, leur gloire la plus pure ne leur
vient pas de leurs aïeux, mais de leur fils, cette fleur de la chevalerie
monastique, comme Godefroy de Bouillon est la fleur de la chevalerie militaire.
Un autre biographe, Jean Rigaud, insinue en passant qu'ils n'étaient pas
indignes de cette gloire. "On reconnaît les parents à leur postérité,
remarque-t-il, comme on connaît l'arbre à ses fruits, la plante à sa racine."
L'éloge est suggestif dans son laconisme, et il nous permet d'accepter plus
facilement les conclusions des écrivains postérieurs, Marc de Lisbonne, Surius,
Wadding, lorsqu'ils nous dépeignent la physionomie des deux époux : don Martin
comme un vaillant chevalier, alliant le courage des preux et la foi des croisés
à la noblesse du sang ; et dona Maria comme une femme de caractère, joignant aux
charmes de la jeunesse et aux grâces de l'esprit ces qualités morales qui sont
l'arôme et la joie des foyers, un cœur généreux, une âme ouverte à tous les
dévouements, une piété tendre et sincère.
"Oh ! l'heureux couple ! Oh ! les
heureux époux !" répéterons-nous avec les chroniques médiévales. Heureux, parce
que le ciel les avait choisis pour être les instruments de ses miséricordieux
desseins sur le XIIIe
siècle ; heureux surtout, parce qu'ils se sentaient assez de courage pour
remplir leur mission.
Tous deux étaient rayonnants de
jeunesse, tous deux pleins de confiance dans l'avenir. Le ciel bénit leur union,
dont notre Bienheureux fut le premier fruit. C'est du moins ce qui ressort des
textes comparés de la légende primitive et de la biographie de Jean Rigaud. "Ses
parents étaient à la fleur de l'âge", lisons-nous dans la première. — "Ils
n'avaient pas encore eu de fils y, ajoute la seconde. Notre Saint fut donc au
moins l'aîné des fils.
Le nouveau-né fut porté en grande
pompe sur les fonts sacrés de la cathédrale, où il reçut le nom de Fernando.
Enfant de bénédiction, mais sans aucun de ces présages ni de ces prodiges qu'on
remarque dans la vie des saint Basile, des saint Dominique, des saint François.
Les abeilles ne déposèrent pas leur miel sur ses lèvres ; sa mère ne fut pas
troublée par des songes ; l'aile des chérubins n'effleura pas son berceau.
Seulement, dans la famille, l'allégresse était débordante; gentilshommes et
bourgeois s'associaient à une joie si légitime, et la demeure du preux
"chevalier d'Alphonse II" retentissait de vœux qui pouvaient paraître
hyperboliques et que la réalité devait pourtant dépasser.
Bientôt, s'il faut en croire
certains légendaires de basse époque, le foyer s'agrandit de trois autres
berceaux, un frère et deux sœurs : Pedro, Maria et Féliciana. Nous nous bornons
à transcrire ces détails dont la justification nous échappe ; et poursuivant
notre marche, nous allons pénétrer dans l'intérieur de la maison prédestinée qui
nous attire, pour essayer d'y surprendre le mode d'éducation qu'employèrent les
parents du Bienheureux.
On aime à se figurer dona Maria
accomplissant en chrétienne les obligations de sa tâche maternelle, façonnant
peu à peu son fils à cette droiture de caractère et à cette estime des grandes
choses qui étaient alors considérées comme le plus bel apanage de la noblesse ;
ouvrant son intelligence à tout ce qui est beau, récompensée dans ses efforts et
souriant avec bonheur à l'éclosion d'un talent qui, plus tard, étonnera l'Europe
entière. Au fait, dans cette formation première qui est l'œuvre et aussi le
mérite de la mère, tout nous échappe, sauf une note prédominante, et combien
harmonieuse, dont les Frères-Mineurs nous renvoient l'écho lointain : c'est la
dévotion à la Vierge immaculée, cette dévotion innée dans le cœur de tout
catholique, mais plus intense chez les saints.
Le culte de la Reine du ciel, éclos
au doux sourire de dona Maria, éclate en effet du berceau à la tombe, à travers
les différentes phases de l'existence de notre Bienheureux. "L'auguste Mère de
Dieu a veillé sur ses premiers pas dans la vertu, nous dit Jean Rigaud ; et,
tout le long de ses jours, elle étend sur lui sa main bénissante," Et lui
s'éprend de bonne heure, pour son aimable protectrice, "d'une filiale tendresse
et d'une confiance qui ne se démentiront pas."
Enfant, il grandit à l'ombre d'un
des sanctuaires privilégiés de Marie, la basilique de Notre-Dame, où il a été
baptisé. Religieux, il prend la Reine des anges pour sa protectrice spéciale.
Apôtre, il sera le chantre de ses grandeurs, l'intrépide défenseur de ses
privilèges, et tiendra à redire que tout ce qu'il a, il le tient des mains de
Marie.
Tout des mains de Marie ! Cette
pensée trouve sa traduction dans une des statues, la plus ravissante peut-être,
de la basilique patriarcale. Le Saint y est représenté en habit de clerc,
soutanelle rouge et cotta plissée, aux pieds d'une majestueuse image de la Reine
des anges, à laquelle il semble dire : "C'est à vous, aimable Souveraine, que je
dois tout, ma vocation, l'auréole de l'apostolat et ma couronne du ciel !"
Radieux de grâce et d'innocence,
prévenu des bénédictions du ciel, nature vive, intelligence précoce, imagination
ardente, vers l'âge de huit à neuf ans, Fernando faisait déjà pressentir ce
qu'il serait un jour. Ses parents, heureux et fiers, n'eurent garde de laisser
en friche un sol si riche et si fécond.
A cette époque, les monastères et
les églises ne manquaient jamais d'ouvrir des écoles où les grandes familles
envoyaient de préférence leurs enfants. L'église patriarcale de Lisbonne
possédait un de ces établissements d'instruction dirigés par des
ecclésiastiques, où les exercices de piété s'alliaient à l'étude des lettres.
Fernand y fut envoyé.
Quelle était alors la matière de
l'enseignement donné à la jeunesse portugaise ? Les chroniques médiévales n'y
font aucune allusion ; mais nous ne croyons pas dépasser les limites de la
vraisemblance, en avançant que l'école épiscopale de Lisbonne était fondée sur
le même type que celle des pays voisins, et qu'en Portugal, comme en France et
en Angleterre, le programme comprenait la grammaire, la rhétorique, la
dialectique et le plain-chant.
Pendant un laps de temps que les
légendes primitives ne déterminent pas, l'enfant prédestiné suivit assidûment
les cours de cette maîtrise. Alerte et vif, comme on l'est à cet âge, gracieux
sous le costume des clercs, heureux lui-même de mêler sa voix fraîche et pure à
celle de ses condisciples, plus heureux encore de servir le prêtre au sacrifice
auguste de nos autels, il étonnait tout le monde par l'harmonique et précoce
développement de toutes ses facultés.
Mais l'homme est un être libre et
il faut pour que sa liberté s'affirme, qu'elle soit soumise à l'épreuve. Nul
n'échappe à cette loi de la Providence, le fils de don Martin pas plus que les
autres. C'est vers la fin de sa vie écolière qu'il fut aux prises, selon Surius,
avec la tentation délicate qui est recueil de la jeunesse. "Il eut à subir, nous
dit l'austère hagiographe, les sollicitations importunes d'une servante légère ;
il résista victorieusement."
La version de Surius, empruntée à
des documents "très antiques", mais que malheureusement il ne désigne pas, a
pour elle, sinon la certitude, au moins toutes les probabilités. A l'âge où
s'éveillent les passions, une tentation se dresse devant le doux adolescent,
inattendue et sous les formes les plus capables d'entraîner un cœur sensible
dans les voies de la volupté. La lutte qu'elle provoque, les violentes émotions
qu'elle soulève, marquent la première étape de sa carrière et décident de
l'orientation de sa marche. Aux clartés de ce duel entre le bien et le mal, il a
mieux compris le but final du terrestre pèlerinage, la nécessité d'y tendre, les
périls de la route ; il a sondé du regard les bas-fonds du torrent fangeux où
s'enlise la jeunesse, et il s'en détourne avec effroi. Effroi bien légitime et
qui se retrouve chez tous les saints ! Ce qui les épouvante, c'est le mal.
Le récit de Surius concorde
parfaitement, du reste, avec le texte des chroniques primitives, qui dépeignent
les effets, sans nous signaler la cause. "L'enfance de Fernando, écrit Jean
Rigaud, s'était écoulée calme et à l'abri des orages sous le toit paternel. En
ouvrant les yeux sur le monde, il fut vivement frappé de deux choses : la
fascination des jouissances matérielles et leur instabilité ; et les réflexions
sérieuses affluèrent dans son esprit."
Chaque jour effeuillait une de ses
illusions, rapporte de son côté le plus ancien de ses biographes ; chaque jour
lui découvrait mieux les périls cachés sous les dehors d'une société qui n'avait
pour lui que des sourires et des rosés. "O monde, s'écria-t-il un jour, tu mens
à toutes tes promesses ! Ta force n'est qu'un roseau fragile, tes richesses
qu'un peu de fumée, tes plaisirs qu'un écueil où la vertu, fait naufrage !"
Vainement faisait-on miroiter à ses
yeux l'éclat des grandeurs assurées à sa naissance et à ses talents. Patrimoine,
titres et dignités civiques, que sont tous ces hochets de la terre au regard
d'une âme qui a, comme la sienne, le vrai sens de la vie ? Il les dédaigna pour
s'attacher à la poursuite de biens meilleurs et plus durables. Il était de ces
êtres prédestinés qu'une voix intérieure pousse au désert. Il écoutait ;
pourquoi résister ?
Enfin sa résolution est prise,
ferme, irrévocable; il se consacrera au service de Dieu. Il fait part de ses
projets "à son père et à sa mère", dans une confidence intime dont Jean Rigaud
ne nous transmet que le résultat. Pour couper court à toute velléité de retour,
"il abdique par écrit ses droits à l'héritage qui lui était dévolu". Cet acte
juridique et la suite du récit ne nous permettent pas de supposer que ses
parents lui aient refusé le consentement désiré. Chez eux, la foi parle plus
haut que le cœur ; ils s'inclinent devant une vocation si manifeste ; et lui,
libre de ses mouvements, franchit à la hâte le seuil de la demeure paternelle,
s'en va frapper à la porte de l'abbaye de Saint-Vincent de Fora, dans la
banlieue de Lisbonne, et sollicite l'honneur d'y être admis, "attiré, nous dit
la Légende primitive, par le renom de science et de sainteté qui s'attachait à
cette maison".
La vocation vient d'en haut, et les
hommes comme les événements ne servent qu'à la préparer, souvent à leur insu,
quelquefois même contre leur gré. Heureux celui qui est l'élu ! Heureux celui
qui entend la voix du Créateur et se lève au premier appel ! Fernando est un de
ces élus, un des plus privilégiés, un des plus fidèles. Son berceau est entouré
de soins vigilants. Son enfance et sa vie écolière sont faites d'amour et de
piété, de respect et de tendresse pour les parents, d'ardeur au travail et de
dévotion à la Reine des Vierges, de foi et de pureté, d'une pureté dont il
commence à connaître le prix et qu'il sait défendre, sans jamais fléchir, contre
les séductions du monde, non moins que contre l'ivresse des passions. Il
apparaît ainsi, au foyer, comme un beau lis, "un lis fleuri," selon la riante
image de Jean Rigaud. Il restera toujours un lis odorant, un lis fleuri. Il a
embaumé la demeure paternelle ; il embaumera de même le cloître, puis les
vallées et les montagnes, la France et l'Italie ; et au soir de ses jours, il
pourra dire de la vertu angélique ce que Salomon a dit de la sagesse : "Je l'ai
aimée, je l'ai recherchée dès l'âge le plus tendre. Je l'ai choisie pour ma
fiancée, et je suis devenu l'amant de son impérissable beauté. Le Seigneur avait
richement doté mon âme, et il m'avait mis au cœur un vif attrait pour le bien.
Chaque jour je croissais en vertu, et j'ai pu de la sorte préserver ma chair de
toute souillure."


 



|
