|
Il a dialogué avec les
grands de son époque; il a combattu la bataille de ce catholicisme libéral qui
allait finir par gagner la guerre dans la démocratie occidentale typique de la
deuxième partie du vingtième siècle; il a écrit des milliers de pages de
philosophie. Mais rien de tout cela ne l’aurait sauvé de l’oubli général si les
rosminiens n’avaient pas été là
par Giuseppe De Rita
C’est un
maitre qui, sans ses disciples, n’aurait pas échappé l’ostracisme culturel et
ecclésial. C’est là que réside le mystérieux mécanisme qui a
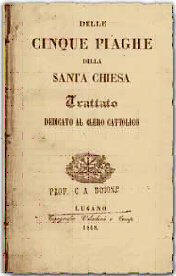 mené,
au bout d’un siècle et demi, à la décision de l’Église de béatifier Antonio
Rosmini. mené,
au bout d’un siècle et demi, à la décision de l’Église de béatifier Antonio
Rosmini.
Celui-ci a
dialogué tout au long de sa vie avec les grands de son époque, de Charles-Albert
de Savoie à Pie IX et à Manzoni; il a mené avec vigueur la bataille de ce
catholicisme libéral qui allait finir par gagner la guerre dans la démocratie
occidentale typique de la deuxième partie du vingtième siècle; et il a surtout
écrit des milliers de pages de philosophie, de culture religieuse, de réflexion
sociale. Mais aucun de ces trois aspects (l’amitié des grands, le fait d’avoir
prophétisé “la liberté catholique” et celui d’avoir écrit des milliers de pages)
n’aurait jamais sauvé Rosmini de l’oubli et de l’ostracisme. Ses ennemis étaient
trop nombreux, surtout dans les rangs de l’Église; sa pensée était et est trop
difficile à saisir; trop nombreux étaient, parmi les professeurs et les clercs,
ceux qui ont préféré le juger trop intelligent pour les pauvres esprits des
fidèles. Et puis le saint Office l’avait mis en pénitence, et cela fournissait
un alibi à tout le monde.
S’il a échappé
à l’oubli généralisé et collectif, il le doit essentiellement aux rosminiens, à
ses disciples de l’Institut de la Charité qu’il a créé, tenacement fidèles à
leur appartenance à l’Église, contre tous les ostracismes. Ce sont les
rosminiens qui, avec leurs écoles, ont formés des dizaines de milliers de jeunes
selon une philosophie de type personnaliste et libérale, implicitement opposée à
la pédagogie étatique totalisante ou à la pédagogie jésuitique militante (à
laquelle je dois d’ailleurs ma manière de raisonner). Ce sont les rosminiens
qui, avec constance, mais sans ostentation puiblique, ont continué pendant des
décennies à poser le problème de la qualité structurelle de l’Église, en faisant
redécouvrir Le cinque piaghe [Les cinq plaies de la sainte Église, œuvre
d’Antonio Rosmini, ndr]
et surtout en proposant la primauté spirituelle de la liberté de l’Église par
rapport au pouvoir temporel. Ce sont les rosminiens qui ont choisi de dialoguer
avec cette partie de l’élite culturelle italienne qui, pendant des décennies, a
cultivé l’esprit démocratique, le sens de la coexistence collective,
l’enthousiasme quotidien de la charité spirituelle au cours de décennies; je
peux témoigner de quel prestige “élitaire” était entouré le père Bozzetti dans
les années de l’après-guerre, et nombreux sont ceux qui peuvent témoigner de la
forte influence exercée par Clemente Riva sur une grande partie de la classe
dirigeante italienne d’aujourd’hui.
Ce sont donc les rosminiens, tenacement
convaincus d’être dans leur bon droit même dans les périodes de plus grande
frustration, qui ont sauvé Rosmini d’un oubli potentiel (et même voulu et
provoqué par de nombreuses personnes). Honneur donc aux rosminiens. Mais honneur
aussi à leur fondateur, s’il est vrai que les leaders se reconnaissent à leurs
disciples: au fond, c’est la profondeur de sa pensée (inépuisable pour ceux qui
l’ont fréquentée) qui a donné une telle force à la volonté des rosminiens d’en
rendre témoignage. Comme le disait Buber «C’est la racine qui porte».
Il est difficile de faire un choix d’importance
relative parmi les composantes de cette “racine”, mais pour l’“affilié
dilettante” que je suis, il semble que Rosmini et les rosminiens ont eu raison
sur quatre grands thèmes: tout d’abord en y insistant et ensuite en les faisant
entrer dans la conscience collective, sans pour autant se mettre en avant ou
battre les tambours médiatiques.
Le premier est celui de la liberté religieuse.
Après le Concile Vatican II, cela semble une évidence. Mais pensons à l’époque
de Rosmini, lorsqu’existaient encore l’État pontifical et le Souverain Pontife
et que personne ne se scandalisait parce qu’il était écrit dans le Statut
albertin que le catholicisme était “religion d’État”. Le seul qui réagit
durement fut Rosmini, qui écrivit: «La religion catholique n’a pas besoin de
protections dynastiques, mais de liberté. Elle a besoin que soit protégée sa
liberté, et rien d’autre». L’Église, étant une société naturelle et spontanée,
ne se condense pas dans le pouvoir, mais elle filtre et pénètre partout comme
l’air et l’eau; et elle a seulement besoin de ne pas être entravée. La foi entre
dans les cœurs sans passer par les pouvoirs au sommet. Rares sont ceux qui, au
cours des décennies marquées par le concile Vatican I, ont eu le courage
d’émettre des affirmations de ce genre.
Le deuxième grand thème rosminien a été la
liberté de la papauté par rapport à son pouvoir temporel. J’ai rappelé dans un
autre contexte une lettre de Rosmini au cardinal Castracane en 1848, dans
laquelle il écrivait: «Si l’unité fédérative de l’Italie avait lieu, le
souverain Pontife resterait un prince totalement pacifique et il enverrait des
nonces pour les affaires spirituelles; et il les enverrait, en plus, non pas aux
princes mais aux Églises du monde». Il avait vu juste et les faits lui ont donné
raison, car ils correspondent aujourd’hui à son option. Or celle-ci, je le
répète, remonte à 1848, c’est-à-dire plus de vingt ans avant l’unification
nationale de 1870.
Les deux thèmes cités jusqu’ici (liberté
religieuse et détachement du pouvoir temporel) se rattachent de manière
souterraine à un autre grand thème rosminien: le refus de la domination du
pouvoir politique, le grand choix qui a fait de Rosmini le paladin italien du
catholicisme libéral, et – à moins que d’aucuns ne soient dérangés par ce terme
– du catholicisme démocratique. J’ai toujours beaucoup apprécié son refus de la
«seigneurie qui ne crée pas société mais domination et servitude», parce que
j’associe aussi cette phrase à une autre qui souligne que «la construction de la
société est un ensemble d’actes et une pluralité de personnes», dans laquelle on
perçoit le début de la thématique du pluralisme culturel et politique et de ce
“développement de peuple” qui a caractérisé la démocratie italienne des
dernières décennies.
J’associe donc spontanément et naturellement cette foi dans le
développement opéré par une pluralité de personnes à une autre
considération, selon laquelle une société composée de si nombreux sujets
ne peut grandir et ne peut explorer sereinement toutes ses possibilités
que si elle respecte et fait respecter tous les droits, et le libre
usage de tous les droits. Le libéralisme de Rosmini, qui lui a procuré
tant de problèmes, à lui et à sa congrégation, n’est rien d’autre: la
société doit être construite de manière telle que chacun puisse avoir le
libre usage de ses propres droits. Tel est le bien commun qui
transparaît de sa complexe réflexion sociopolitique: la centralité du
sujet, tant qu’elle reste fermée sur elle-même, est privée de vitalité,
elle ne devient vitale que lorsqu’elle entre en relation avec les autres
et «conspire avec les autres à la création d’une société qui ait pour
fin commune le libre usage des droits».
On peut
imaginer, à ce stade, combien j’aimerais poursuivre dans les voies ouvertes par
ces thématiques: la valeur de la subjectivité individuelle comme grand moteur
social, quand elle ne se fait pas tenter par le subjectivisme éthique; la valeur
de la relation comme parcours de vies qui ne s’enferment pas dans l’autocensure,
qu’il s’agisse de narcissisme et/ou de dépression; la valeur du rapport avec les
autres, avec “l’autre de toi” comme vraie route qui permet d’arriver à l’Autre
absolu. Mais ces parcours seraient trop longs, ils obligeraient à entrer dans
des questions et des disputes qui animent le débat philosophique et sociologique
de notre époque. Je m’oblige donc à les éviter parce que je veux rester fidèle à
l’intention dans laquelle j’ai commencé à écrire: celle de démontrer que Rosmini
était certainement un grand homme, mais qu’il a eu la chance que ses rosminiens
aient défendu ses idées (la liberté religieuse, la fin du pouvoir temporel,
l’option pour le pluralisme démocratique, la foi en un développement à plusieurs
sujets) pendant des décennies en les développant, en les accompagnant au cours
du temps et en en faisant non plus des questions d’une minorité réprouvée, mais
d’une aile combattive de l’Église dans son évolution historique des cent
soixante dernières années. Ils ont été humblement fidèles à l’Église et à leur
fondateur et prophète; ils méritent tous, même ceux qui ne sont plus, de
considérer le fait d’être arrivés à cette béatification comme leur victoire
personnelle.
Septembre 2007 |
